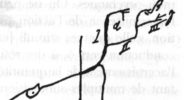Année 2019-2020
L’ÊTRE EN QUESTION
PARADIGME ET TRANSDUCTION. QUANTITÉ ET SENS. SOLIPSISME OU INTERSUBJECTIVITÉ?
Dominique Scarfone
Si on est en droit de penser que tout ce que l’humain pense, dit ou fait est en réalité une tentative de réponse à une question, il reste que cette question peut ne pas avoir été formulée consciemment, voire, pas formulée du tout. L’expression « être en question » décrirait plutôt une situation de base de l’être humain, exposé comme on l’a vu à l’énigme du message de l’autre et, par la suite, à sa propre énigme qu’est l’inconscient. Pourquoi alors poser le problème en termes de « questions » ? Il faut accepter d’élargir le sens de ce mot si l’on considère que chez l’humain la psyché-corps est constamment excitée, dérangée, intriguée, irritée, sollicitée, séduite, provoquée, bref, interrogée par ce qui vient de l’autre. Je vous soumets donc l’idée que tout ce qui nous déporte un tant soit peu de notre continuité, de notre routine, de notre somnolence, de notre continuel discours intérieur etc. cela peut se concevoir comme une « question ». Le mot même de « question » remonte au latin quaestio qui lui-même dérive du verbe quaerere = quérir qui va aussi avec enquêter. La question correspond donc, sans surprise, à la quête. Mais il y a eu aussi la pratique de « questionner », ce qui pouvait se dire aussi « soumettre à la question », qui signifiait interroger, en usant au besoin de la torture pour arracher des aveux… Une « question » a aussi pris le sens d’un sujet à controverse, voire d’une dispute, d’un débat (disputatio étant une discussion). Histoire de dire que « question » n’est pas un mot quelconque.
Le dérangement, le trouble, l’interrogation, nous pouvons le signaler par des questions, implicites ou explicites : « Qu’arrive-t-il ? Qu’y a-t-il ? Que me veut-on ? Pourquoi moi ? » etc. Ces interrogations mettent en marche la fonction fondamentale de la psyché déjà évoquée, qui est de « traduire »1 et, traduisant, de construire du sens. Je rappelle à présent que si la psyché a besoin de formuler des réponses, c’est pour diminuer la tension produite par les « questions » que lui pose la rencontre de l’altérité. Cette baisse de tension, c’est tout le sens du principe de plaisir tel qu’invoqué par Freud à la suite de Fechner, principe qui s’accorde avec celui de von Helmholtz, selon lequel la tâche essentielle du système nerveux central, c’est d’abaisser au plus bas niveau possible la quantité d’énergie libre. Cette notion d’énergie libre renvoie, notons-le, au point de vue économique de la métapsychologie de Freud. Elle a été examinée par Breuer et Freud dès les Études sur l’hystérie (1895), et Freud la reprendra fréquemment par la suite, y compris assez tard dans son œuvre, dans Au-delà du principe de plaisir (1919-20). Là, Freud affirme à son tour que la tâche fondamentale de la psyché peut se formuler en termes économiques comme la tâche de lier l’énergie d’excitation. Un échec grave de cette liaison, c’est ce qui produit un traumatisme psychique.
En revenant ainsi au point de vue économique, nous nous inscrivons dans la ligne des souhaits de Freud qui déplorait souvent le trop peu d’usage qu’on fait de ce point de vue dans les écrits psychanalytiques. Ce point de vue concerne la notion de quantité et correspond donc à ce qui échappe à la représentation, du moins tant que la quantité en question (!) n’a pas été « enrobée » dans une forme (ou, si l’on préfère, tant que la quantité ne s’est pas investie dans une forme). Dans un des premiers textes métapsychologiques, intitulé « Les névropsychoses de défense »2 Freud termine par cette remarque:
« Je vais pour finir rappeler en peu de mots la représentation adjuvante dont je me suis servi dans cette présentation des névroses de défense. C’est la représentation selon laquelle, dans les fonctions psychiques, quelque chose est à différencier (montant d’affect, somme d’excitation) qui a toutes les propriétés d’une quantité – bien que nous ne possédions aucun moyen de mesurer celle-ci –, quelque chose qui est capable d’agrandissement, d’amoindrissement, de déplacement et d’éconduction [décharge], et qui s’étend sur les traces mémorielles des représentations, un peu comme une charge électrique sur la surface des corps. » (p. 17-18, italiques ajoutés par moi.)
Dans cette citation, c’est la quantité qui, comme une charge électrique, « enrobe les traces mémorielles de représentations ». Dans le cas Dora, Freud parle au contraire de l’enrobage psychique (donc: enrobage par la représentation) d’un noyau de névrose actuelle. On voit donc que l’on peut, indifféremment, se représenter la quantité comme enrobée de représentation ou, comme ci-haut, la quantité qui s’étend sur les traces des représentations (notons l’expression). Quelle que soit l’image que l’on se donne, on voit que la quantité ne voyage pas seule. Il y a toujours une forme qui enrobe – ou est enrobée par – la quantité d’énergie. J’emploie le mot « enrobée » pour dire que la quantité ne s’est pas transformée en qualité, mais que la forme se prête (c’est encore l’Entgegenkommen dont nous avons déjà parlé) à la quantité (ou que la quantité se prête à la forme). Cette prestation mutuelle est une liaison et comporte de ce fait un délai, voire une inhibition de la décharge. Mais l’inhibition est seulement partielle parce qu’on peut noter que la jonction forme-quantité, permet que la quantité soit perçue; or cette manifestation de la quantité se trouve à baisser la tension, agissant ainsi comme une décharge modulée. Il s’agit de la dimension affective de toute représentation et de son expression.
Au plan clinique, c’est ce dont parle Freud en 1914 en introduisant la notion de perlaboration (Durcharbeitung, Working-through): processus qui est lent – « une épreuve de patience », écrit Freud – mais qu’on « peut mettre en parallèle avec l’“abréaction” des montants d’affect restés coincés »3 Cette fonction d’inhibition par la liaison de la quantité dans une forme n’est pas sans rappeler aussi le commentaire de Freud à propos du moi, dans le Projet de 1895, à savoir que sa seule présence a un effet d’inhibition. Or dans ce texte, le moi n’est autre qu’un ensemble de « neurones » bien frayés (on peut aussi dire: représentations interconnectées); par conséquent on peut dire que le moi n’est autre qu’une forme se prêtant à la circulation de la quantité d’excitation. On peut dire aussi qu’une fois que cette forme centrale du moi est en place, les autres formes – celles qui seront trouvées ensuite du fait de la tra(ns)duction – auront tendance à s’agglutiner à cette forme principale, et cela selon le principe même du frayage qui a présidé à la formation et au maintien du moi et qui donne lieu à ce qu’il appelle alors « investissement latéral ».
Une digression : Simondon, la transduction et l’individuation
Il me faut ici, avant de poursuivre, introduire quelques notions prises chez Gilbert Simondon, un philosophe qu’on gagne à connaître. Je m’intéresse ici à son ouvrage intitulé L’individuation psychique et collective4, où se trouve mise au centre la notion de transduction. Bien que je me sois intéressé à la transduction longtemps avant de connaître l’œuvre de Simondon, je crois que l’on trouve chez lui une conception de la chose qui a beaucoup de résonances avec ce dont j’essaie de traiter ici. Comme le titre du livre l’indique, Simondon parle avant tout d’un processus d’individuation, qu’on peut à mon avis aussi appeler « différenciation ». Simondon prend comme modèle de base un processus très élémentaire: celui de la formation d’un cristal au sein d’une solution sursaturée. En effet, mettez plus de sel que ne peut en dissoudre un liquide à la température de la pièce, mais en ayant chauffé ce dernier pour qu’il en dissolve la totalité, puis refroidissez le liquide lentement et insérez un « germe de cristal », et vous verrez se former autour de ce germe un cristal qui se met à croître de façon très ordonnée comme si une main invisible le façonnait très méticuleusement. Évidemment, il n’y a pas de main invisible. Il y a le processus que Simondon appelle transduction, qui signifie la reproduction de proche en proche d’une même structure. La structure cristalline existante semble « inviter » (autre version possible de l’Entgegekommen) les sels en solution sursaturée à venir s’organiser selon le même patron autour d’elle.
On aura reconnu dans ce « de proche en proche » l’idée de paradigme selon Agamben que nous a exposée Richard Simpson la fois dernière et qui frappe par la description d’un processus très semblable à celui de transduction. Comme je le signalais l’autre jour, le terme de transduction avait déjà été utilisé par Jean Piaget lorsque celui-ci établissait que la logique de l’enfant, au stade de pensée qu’il nomme « pré-opératoire », n’est ni inductive ni déductive, mais transductive, ce qui correspond presque mot pour mot à ce qu’écrit Agamben, cité par Simpson: « Le paradigme est une forme de connaissance ni inductive ni déductive, mais analogique, qui procède de singularité en singularité »5. Piaget dit que l’enfant au stade de pensée pré-opératoire utilise « le raisonnement transductif qui conclut du singulier au singulier »6. Il nous faudrait un trop long détour pour examiner le fait que Piaget associe cette logique transductive à la notion de participation dans la pensée « primitive », qu’il définit ainsi:
« Nous appellerons « participation », conformément à la définition donnée par M. Lévy-Bruhl, la relation que la pensée primitive croit apercevoir entre deux êtres ou deux phénomènes qu’elle considère soit comme partiellement identiques, soit comme ayant une influence étroite l’un sur l’autre, bien qu’il n’y ait entre eux ni contact spatial, ni connexion causale intelligible. On peut discuter l’application de ce concept à la pensée de l’enfant, mais c’est une question de mots. Il se peut que la participation chez l’enfant diffère de la participation chez le primitif. Mais elles se ressemblent et il suffit de cela pour que nous soyons autorisés à choisir notre vocabulaire parmi les expressions les plus adéquates qu’on ait trouvées pour peindre la pensée primitive : nous ne préjugeons pas, pour autant, de l’identité des différentes formes de participation que l’on peut distinguer. » (op. cit. p. 113, italiques ajoutés par moi).
Je laisse de côté la discussion de ce qu’il faut entendre par « primitif », notion aujourd’hui fort critiquée, et pour cause. Retenons pour le moment que si cela semble loin de la croissance des cristaux décrite par Simondon, à laquelle Piaget ne pensait probablement pas, il est néanmoins à noter que dans les deux cas la logique semble comparable: « de proche en proche », « du singulier au singulier » semblent décrire un même type de mouvement. Simondon dit par ailleurs qu’un nouveau cristal qui vient de s’ajouter à la masse cristalline en croissance sert à son tour de modèle (on pourrait dire de paradigme) pour les formations de cristal qui suivront.
Cela pose la question de savoir ce qui se passe quand certaines formes produites ne s’associent pas facilement au moi et restent dans la zone intermédiaire entre inconscient et préconcient-conscient. Freud les appelle les rejetons de l’inconscient.7 Mais quelles sont les caractéristiques qui font que ces formes s’intègrent moins facilement que d’autres dans le moi ? Nous avons l’impression qu’il faut dans ce cas considérer que ces formes restent porteuses de « restes pulsionnels », c’est-à-dire, sont encore dotées d’un quantum d’énergie non-liée. La forme intermédiaire ainsi trouvée n’a pas totalement lié le quantum d’énergie et par conséquent ne peut pas totalement être « intégrée » au moi.8 Les formes intermédiaires dans lesquelles Freud voit des rejetons de l’inconscient, qui « appartiennent qualitativement au système Pcs [c’est-à-dire : ils ont une forme] mais de fait à l’Ics. [c’est-à-dire : ils son encore essentiellement porteurs d’une énergie non-liée] »9.
Évidemment, on peut pousser la question plus loin. En réalité, il ne saurait y avoir quoi que ce soit de différencié et encore vivant, qui ne serait pas porteur d’un charge d’énergie encore disponible (énergie libre). Ainsi, Simondon écrit:
« …l’individu comme être défini, isolé, consistant, [entendre, un élément différencié] ne serait qu’une des deux parts de la réalité complète […] il serait le résultat d’un certain événement organisateur […] le partageant en deux réalités complémentaires: l’individu et le milieu associé après l’individuation; le milieu associé est le complément de l’individu par rapport au tout originel. »10
Si l’on voulait absolument traduire cela en langage métapsychologique on pourrait dire qu’un quantum d’énergie psychique trouve dans le champ où il apparaît un « germe organisateur », ce qui donne lieu à une différenciation [Simondon dit: individuation] au sein de ce champ entre une forme et ce qui devient son milieu parce que la forme n’a pas absorbé toute l’énergie. Or, ce qui importe, c’est qu’aucun système vivant ne peut rester tel sans avoir un milieu associé qui lui procure en continu cette énergie. Simondon appelle cela la « métastabilité » du système, puisque une stabilité totale, obtenue une fois pour toutes, c’est tout simplement la mort.
La formation du moi au sein d’un ensemble ? au départ indifférencié, telle que la décrit Freud dans le Projet me semble correspondre tout à fait à cette idée. Le moi s’organise par voie de frayage qui forme un tout métastable avec les « neurones » qui ne s’y sont pas associés et où l’énergie circule librement.
Mais on peut poursuivre sur cette lancée en se demandant si, dans les faits, le moi lui-même ne serait pas cette sorte de système hybride, comme se le représentait d’ailleurs Freud dans Le moi et le ça, tendu entre inconscient et préconscient-conscient, avec des racines dans le ça et des antennes dans le système perception-conscience orienté vers le monde extérieur (Pc-Cs d’où arrivent les « germes organisateurs). Le moi lui-même serait subdivisé en une part très (voire trop) cohérente, faite d’habitus, de traits de caractère difficilement amovibles, et une part plus mobile, dotée d’une énergie moins liée. Nous le retrouverions ainsi d’une part, selon la définition classique, comme « surface » et « projection d’une surface », mais peut-être plus encore comme interface entre l’inconscient et le monde extérieur. Dans ce sens, le moi ne peut-être que métastable, toujours remis en question, tant par ce qui vient du refoulé (autre « intérieur », si on veut) que de ce qui vient de l’autre extérieur, et le forçant à perpétuellement se questionner…
Qu’entendons-nous par « quantité »?
Revenons brièvement à la notion de transduction. Si on pense à ce qui se passe quand la quantité est « captée » dans une forme, enrobée par elle, on voit tout de suite que le terme de traduction ne saurait convenir. La quantité, en effet, ne se présente pas comme un système de signes qu’on pourrait traduire en un autre système de signes. La quantité d’excitation est largement étrangère au « signifier que », mais aussi relativement indépendante du « signifier à » que pourtant elle accompagne. À supposer que l’on puisse mesurer l’excitation, on ne noterait pas nécessairement une correspondance entre l’intensité du message émanant de l’autre et la quantité d’excitation que cela cause au pôle récepteur. Un « message » quantitativement très « ténu » peut avoir valeur traumatique.
Rappelons que nous sommes en présence de systèmes opérationnellement clos (Varela). Cette clôture n’est pas de type géographique, mais plutôt de type fonctionnel. Quelque chose se présente au pôle perceptif du système et y cause un dérangement auquel le système répond d’abord en se réorganisant lui-même, selon ses propres lois de fonctionnement. L’organisme récepteur ne laisse donc pas « entrer » le sens, il le construit à partir de l’ensemble des stimuli perçus. Jusqu’à un certain point, cela est vrai même dans la traduction littéraire : le traducteur élabore un sens à partir de sa propre langue (langue d’arrivée), en respectant autant que possible les lois propres à celle-ci, mais il peut arriver que le travail de traduction l’oblige à créer des formes nouvelles dans la langue d’arrivée. Cet aspect de « construction » est dramatiquement plus apparent dans le cas de la transduction parce que, comme on a déjà vu, ce qui est à transduire ne se présente pas comme système de signes, mais essentiellement comme quantité, voire, dans le cas de l’infans, comme bruit. La quantité qui nous importe en psychanalyse, ce n’est donc pas la quantité en tant que mesurable (p. ex. masse, poids, largeur, voltage) mais plutôt en tant que pouvant ou non être liée au sein d’un sens. Notons ici qu’une forme linguistique qui nous est totalement étrangère se présentera à nos oreilles comme plus proche du bruit que du sens, même si on a l’intuition qu’elle véhicule une intention de communication.
Du solipsisme freudien
Le mécanisme de la transduction sur lequel je reviens n’est pas aussi éloigné de nos préoccupations pratiques de psychanalystes qu’il peut le sembler. En réalité il a des implications assez immédiates pour ce qui se passe dans le cours de l’analyse, notamment quant à la question du transfert et de l’interprétation/construction. Mais avant même de parler de ces aspects assez centraux, notons combien la notion de transduction, avec sa nécessaire construction à partir de ce qui arrive au pôle récepteur, rend compte aisément des « malentendus » se produisant en séance tout comme dans la vie ordinaire. En effet, s’il s’agissait de simplement traduire ce que l’autre dit, on pourrait à la limite recourir à un dictionnaire (certaines pratiques, caricaturales, font à peu-près cela: « Vous avez dit x, dira l’analyste omniscient, mais vous vouliez dire y »). Or, la prise en compte de la clôture opérationnelle de tout système psychique et du processus de transduction qui opère à ses frontières, avec sa nécessaire construction du sens, cela pose une objection majeure aux approches dites « relationnelles » ou « intersubjectives » – dans la mesure où l’intersubjectivité est entendue au sens de deux subjectivités qui échangent entre elles et partagent des contenus communs. Ce sur quoi j’insiste ici, c’est que du fait de la construction autonome du sens, il y a de bonnes raisons de ne pas lâcher le point de vue freudien que l’on a trop facilement taxé de « solipsiste » en donnant, bien entendu, à ce mot un sens totalement péjoratif.
Il est indéniable que Freud a généralement examiné les choses dans le cadre de la psyché individuelle. On sait aussi qu’avec l’abandon de la théorie de la séduction il a relégué au second plan la « primauté de l’autre », selon l’expression de Laplanche. Cependant, il convient de souligner qu’aborder, comme il l’a fait, la psyché individuelle en tant qu’organe séparé correspond tout à fait à la notion d’autopoïèse et de clôture opérationnelle (Varela, Luhmann) ou de « système métastable » (Simondon). Mais il faut aussi noter que Freud a bien tenu compte de la possible rencontre de deux psychismes, et il a même, à l’occasion, employé une métaphore qui aurait pu être un bon exemple de transduction, c’est-à-dire la métaphore du téléphone! Il vaut la peine de citer Freud in extenso. Il vient de donner plusieurs conseils aux médecins (analystes) et il arrive à cette conclusion:
« [Les règles déjà énoncées] veulent toutes créer chez le médecin le pendant à la “règle fondamentale psychanalytique” établie pour l’analysé. De même que l’analysé doit communiquer tout ce qu’il attrape au vol dans son auto-observation, en refrénant toutes les objections logiques et affectives qui veulent l’inciter à faire une sélection, de même le médecin doit se mettre dans la situation d’exploiter aux fins de l’interprétation, de la reconnaissance de l’inconscient caché, tout ce qui lui est communiqué, sans remplacer par une censure personnelle la sélection à laquelle renonce le malade; pour le résumer en une formule: il doit tourner vers l’inconscient émetteur du malade son propre inconscient en tant qu’organe récepteur, se régler ainsi sur l’analysé comme le récepteur du téléphone est réglé sur la platine. »[11, Freud, 1912: « Conseils au médecin dans le traitement psychanalytique », OCFP, vol. X1, p. 149-150.]
On pourrait comprendre cette métaphore comme allant de soi: l’inconscient du patient « émet » et celui de l’analyste « reçoit »… quoi de plus évident ? Cependant, Freud file la métaphore un peu plus avant :
« De même que le récepteur transforme en ondes sonores les oscillations électriques de la ligne induites par des ondes sonores, de même l’inconscient du médecin est apte à rétablir, à partir des rejetons de l’inconscient qui lui sont communiqués, cet inconscient qui a déterminé les idées incidentes du malade. » (p. 150.)
Il était tentant de voir dans ce dernier passage une allusion de Freud au mécanisme de transduction, au sens que j’ai indiqué. Hélas! Il semble bien que ce n’est pas ce qu’il a en tête. Il sait bien que dans le modèle métaphorique qu’il invoque surviennent des changements successifs quant à la sorte de « véhicule » : ondes sonores –> oscillations électriques –> ondes sonores, mais il semble néanmoins croire que l’inconscient de l’analyste peut reconstruire ce qu’émet l’inconscient de l’analysant tout aussi fidèlement que le récepteur téléphonique reproduit les ondes sonores émise à l’autre bout du fil par l’émetteur. Toutefois, Freud semble aussi conscient de la limite inhérente à la métaphore téléphonique puisqu’il poursuit en recommandant à l’analyste de s’être soumis lui-même à une « purification psychanalytique » afin, visiblement, de réduire les interférences dans la réception que peuvent provoquer ses propres « complexes personnels ». Il semble donc d’une part conscient de la transformation des « oscillations électriques » en « ondes sonores », mais d’autre part il semble croire possible que l’analyste « purifié » par sa propre analyse, soit capable d’une réception « nette » de ce qu’émet l’inconscient de l’analysant.
Cela demande évidemment commentaire. On peut d’une part avoir l’impression que Freud croit à la communication d’inconscient à inconscient. Et cependant, si nous prenons sa métaphore plus à la lettre qu’il ne le fait lui-même, nous pouvons lui rétorquer que justement, le modèle téléphonique, avec ses deux transformations successives du signal – sans compter le bruit inévitable, voire la « friture » possible sur la ligne – suppose que la réceptivité que peut offrir l’analyste ne saurait être totalement fidèle. C’est que la psyché de l’analyste ne peut abolir sa propre clôture opérationnelle. Ce qu’émet l’inconscient de l’analysant va bien entendu susciter une « réponse » dans l’inconscient de l’analyste, mais rien ne saurait garantir la parfaite adéquation de ce que l’analyste reçoit avec ce que l’analysant émet, ni par conséquent l’adéquation de la réponse.
C’est bien à ce constat que Freud parvient vers la fin de sa vie, dans « Constructions dans l’analyse ». L’analyste, dit-il, « a à deviner l’oublié à partir des indices que celui-ci a laissés derrière lui ou, pour parler plus exactement. de le construire »11 Il écrit aussi « Nous ne tenons la construction isolée pour rien d’autre qu’une supposition qui attend examen, confirmation ou rejet. » (p. 69, italiques ajoutés par moi.) Et d’où viendra cette confirmation ou ce rejet? Selon que l’on obtient ou on du nouveau matériel: s’il ne se passe rien, on aura seulement perdu tu temps. Du matériel nouveau suggère au contraire qu’on est sur la voie juste. Une preuve indirecte, c’est une expression comme: « Je n’aurais jamais pensé cela (à cela) » (p. 67.) Pour finir, il semble ne pas avoir vraiment besoin d’atteindre à la remémoration elle-même. Il conclut en effet :
« La voie qui part de la construction devrait se terminer dans le souvenir chez l’analysé; elle ne va pas toujours aussi loin. Bien souvent on n’arrive pas à amener le patient au souvenir du refoulé. En revanche, en conduisant correctement l’analyse on obtient chez lui une conviction assurée de la vérité de la construction, ce qui du point de vue thérapeutique a le même effet qu’un souvenir recouvré. Dans quelles circonstances cela a lieu et de quelle façon il est possible qu’un substitut apparemment imparfait produise quand même un plein effet, cela reste matière pour une recherche ultérieure » (p. 69-70.)
À ma connaissance, Freud, décédé deux ans plus tard, n’est revenu sur cette question que brièvement dans l’Abrégé de psychanalyse, écrit inachevé de 1938, mais sans y apporter du nouveau.12 Pour ma part, je crois qu’il y a lieu de reprendre la discussion sur ce sujet en parcourant successivement les textes cités de 1912, mais aussi celui de 1914, intitulé « Remémoration, répétition, perlaboration », déjà cité, pour revenir ensuite à celui de 1937 sur les constructions. On pourrait peut-être s’apercevoir alors que Freud nous a fourni quelques outils qui nous aident à déplacer le problème, à l’inscrire dans une autre perspective que celle du « souvenir recouvré ».
Retour à 1914
Relisant « Remémoration, répétition, perlaboration » on s’aperçoit en effet que ces trois termes donnent des buts de l’analyse une image bien plus fine que celle de banalement « lever l’amnésie ». Car encore faut-il se demander ce que signifie « se remémorer », ce que cela change. Le texte de 1914 exige une certaine exégèse afin de préciser le sens des termes. Va encore pour le terme de répétition, quoique là aussi il faut apporter des précisions. Mais les termes de remémoration et perlaboration demandent réflexion. Comme j’ai déjà discuté assez en détail de cette question, je me permets de renvoyer ici à un texte qui date de 2007 au sujet de la répétition, mais qui concerne aussi la remémoration. (Pour la version en anglais, voir ici.)
Ce que je veux surtout souligner par ce retour au texte de 1914, c’est qu’il offre déjà une perspective originale par rapport au problème des constructions, que ce soit en tant que prélude à la remémoration ou en tant que qu’elles y suppléent. Si se remémorer, c’est amener ce qui se répète à se « reproduire dans le domaine psychique », alors il ne s’agit pas tant de retrouver le souvenir précis – car n’oublions que la déformation nous prive de toute précision en ce domaine (cf. Udo Hock). Il s’agit plutôt d’entraîner une modification économique au sein de la psyché. La répétition est de l’ordre de l’acte, ce qui la tire du côté de la décharge et contourne les processus de remémoration. La remémoration, quant à elle, introduit un retard dans la décharge, le fonctionnement psychique étant maintenu au plan le plus élevé, celui de la pensée. On a vu plus haut que Freud lui-même voit dans « Je n’avais pas pensé cela (à cela) » une bonne indication de la justesse du travail d’analyse. Mais ne « ne pas y avoir pensé » peut très bien signifier que c’est maintenant la première fois qu’on y pense. Cela se présente comme une question de technique, mais il y a aussi des conséquences éthiques.
Du point de vue technique, avec sa métaphore téléphonique de 1912, Freud semblait considérer l’écoute analytique comme devant capter des formes inconscientes qui auraient été toutes faites pour être reflétées telles quelles à l’analysant. Or on aurait pu, déjà à cette époque, opposer plusieurs arguments à une telle conception. On aurait pu faire valoir, entre autres choses, que le travail de l’analyste n’est pas de redire en d’autres mots ce que l’on suppose présent dans la communication inconsciente de l’analysant (à l’exemple du « dictionnaire » mentionné plus haut), mais d’aider ce dernier à déconstruire son propre discours pour, chemin faisant, voir émerger des pensées inattendues. On s’entend que celles-ci doivent à leur tour être interprétées, mais il est d’expérience commune que s’offrent alors à l’analyste plusieurs interprétations possibles et qu’il n’existe pas de manuel pour l’aider à choisir. L’analyste doit donc autant que possible laisser opérer en lui ce que Michel de M’Uzan appelle un « darwinisme interprétatif » : entre plusieurs formulations possibles, une d’entre elles aura pris de l’avance, reléguant les autres à l’arrière plan, mais rien ne dit que l’interprétation qui a eu la préférence était nécessairement la meilleure. L’essentiel est ici de nature éthique : l’analyste doit tout faire pour ne pas choisir en fonction de ses propres préjugés moraux, ni de ses propres préférences théoriques; pour cela, il doit veiller sur la méthode, ce qui revient aussi à laisser le processus se déployer avec le moins d’interférences possibles.
Laplanche, qui insiste sur la primauté de l’autre, a néanmoins posé qu’arrive un moment dans l’organisation du moi où celui-ci se ferme sur lui-même. Il appelle cela la « clôture ptolémaïque », par référence au système astronomique de Ptolémée qui plaçait la terre au centre et posait que le soleil, la lune et les étoiles tournaient autour d’elle.13 De même, une fois refermé sur lui-même, le moi se sent au centre, voire se considère comme le tout de la personnalité psychique. Mais cet « égo-centrisme » correspond tout de même à une réalité. Walter J. Freeman, neurophysiologiste respecté de l’université Berkeley, a pu démontrer qu’il existe nécessairement, au plan cérébral, ce qu’il a appelé un « solipsistic gulf », un « fossé solipsiste ». Freeman a montré, expériences à l’appui, que le cerveau ne reçoit pas de l’information, mais la construit de l’intérieur à partir des stimuli venant de l’extérieur. Il a montré que même quand les stimuli sont identiques d’une fois à l’autre, le cerveau y répond de façon certes semblable, mais jamais identique. Les tracés électro-encéphalographiques de la perception de stimuli répétés à l’identique montrent que d’une fois à l’autre il y a, oui, une sorte de noyau commun reconnaissable (comme la signature des stimuli en question), mais que pourtant le tracé d’ensemble varie grandement. Il y a donc, même au niveau strictement neuronal, un degré de « construction solipsiste ».14
Si même au plan cérébral il n’y a pas transmission mais construction de l’information, alors on ne saurait croire non plus à la transmission directe d’un sens qui serait capté par l’analyste et renvoyé à l’analysant par l’interprétation. On a plutôt affaire à une incitation à construire du sens. L’analyste n’est donc pas un interprète qui trouve du sens à communiquer à l’analysant. Même quand il se conduit comme si c’était le cas, l’analyste ne fait que construire. L’interprétation, quant à elle, est une intervention ponctuelle, une sorte de « signalement », si l’on peut dire, par lequel est mobilisée l’attention de l’analysant. Après quoi les fonctions tra(ns)ductives de ce dernier construiront le sens par elles-mêmes. Il s’ensuit que l’approche « intersubjective » et le recours à la « compréhension empathique » sont des méthodes fort douteuses puisqu’elles supposent un passage du sens d’un membre à l’autre du couple analytique, en plus de se fier aveuglément aux manifestations d’affect, en oubliant leur grande déplaçabilité et donc leur capacité de nous induire en erreur. 15 L’expérience montre au contraire que la communication est marquée par le malentendu, jusques et y compris dans ce qu’on se dit à soi-même. Sans quoi on n’aurait nul besoin de psychanalyse ! Plus encore, la réflexion nous conduit à poser que, pour des raisons à la fois techniques et éthiques, il ne saurait y avoir de « bien entendu ». L’accord entre deux ou plusieurs psychés individuelles se passe le plus souvent à un tout autre plan que celui de la réalité objective, un plan qui concerne l’Éros, comme nous le discuterons plus tard. Je dis bien l’Éros et non le Sexuel, pour marquer que l’Éros désigne un sexuel « atténué », « canalisé », ou si l’on veut « désexualisé », et qui relève du le régime narcissique de la libido, et, par là, de la psychologie de masse. Tout « bien entendu » mérite de ce fait d’être… mis en question.
- Comme déjà signalé. il serait plus exact de parler de transduction plutôt que de traduction. ↩
- S. Freud, 1894, OCFP, vol III, p. 3-18. ↩
- S. Freud, 1914, Remémoration, répétition et perlaboration, OCFP, vol. XII, p. 195-196. ↩
- Paris, Aubier, 1989. Livre qui n’est en réalité qu’un chapitre d’un ouvrage plus volumineux: L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Édition Millon, collection « Krisis », 2017. ↩
- G. Agamben, Signatura rerum. Sur la méthode. Paris, Vrin, 2008, p. 34. ↩
- J. Piaget, La représentation du monde chez l’enfant, Paris, PUF, 1947/2013, p. 142. ↩
- Voir « L’inconscient », 1915, OCFP, vol. XIII, p. 231. ↩
- Il y a lieu d’ailleurs d’interroger ce terme d’intégration, dont ont fait couramment usage sans trop préciser ce qu’on entende par là. ↩
- Op. cit. p. 231. ↩
- Simondon, L’individuation à la lumière…, op. cit. p. 63. ↩
- S. Freud, Constructions dans l’analyse, OCFP, vol XX, p. 62. ↩
- S. Freud, Abrégé de psychanalyse, OCFP, vol. XX, p. 270-271. ↩
- Il faut souligner ici que la clôture ptolémaïque du moi referme aussi la psyché dans son ensemble. Voir l’article 4. ↩
- Voir Freeman, W.J., Societies of Brains. A study in the neuroscience of love and hate. Hillsdale N.J. Lawrence Erlbaum, 1995, et How brains make up their minds, London: Weidenfeld & Nicolson, 1999. ↩
- Laurence Kahn, L’analyste apathique et le patient postmoderne, Paris, L’Olivier. ↩