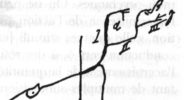Je commencerai par souligner combien les remarques de Lawrence Friedman sur lesquelles Richard Simpson a attiré notre attention l’automne dernier convergent avec l’idée générale de processus psychiques plutôt que d’entités fixes. On pourrait objecter que la psychanalyse a depuis toujours parlé de processus, ce qui est absolument vrai. Sauf que la tendance spontanée a toujours aussi été d’imaginer des processus se déroulant dans des espaces psychiques : ainsi, on peut facilement entretenir l’image des processus primaires se déroulant dans l’inconscient, les secondaires dans le conscient. Or, je propose que ce n’est pas du tout ainsi que les choses se passent. Si l’on part des processus eux-mêmes, si on en fait l’aspect fondamental de ce qui intéresse la psychanalyse, alors les notions de conscient, pré-conscient ou inconscient n’en sont pas les contenants. Ce sont tout au plus des formes figurées, des fictions certes utiles, mais des fictions tout de même. Rappelons que c’est avec ce terme de « fiction » que Freud qualifiait l’appareil psychique, par exemple. De même, à propos des pulsions, il n’hésitait pas à dire que ce sont « des êtres mythiques… grandioses dans leur indétermination ». Et pourtant, il ajoutait aussitôt qu’il ne pouvait en faire abstraction dans son travail.
Nous avons déjà abordé la question des pulsions lors de notre série de rencontres de l’hiver-printemps, aussi je ne reviendrai pas sur elles explicitement. Je voudrais plutôt m’attarder maintenant sur le terme « fiction » qui me semble valoir quelques efforts de réflexion.
La question peut se poser ainsi: si l’appareil psychique et même les pulsions ne sont, de l’aveu même de Freud, que des fictions ou des mythes, cela signifie-t-il que l’ensemble théorique freudien ne repose sur rien de solide ? Qu’il n’est qu’une invention surgie de l’imagination d’un médecin viennois en mal de notoriété ? Évidemment que non. Mais alors il nous faut pouvoir dire de quoi est faite la psychanalyse, quels sont les référents qui correspondent aux signifiants tels que: pulsion, inconscient, fantasme, appareil psychique, résistance, perlaboration.
Ce que notre étude amorcée cet automne nous permet d’avancer est que la notion de processus, avec les termes apparentés de mouvement, motion, événement psychique etc. rendent bien compte de ce dont il s’agit. En d’autres mots, tout ce que la psychanalyse postule est mouvement, même ce qu’on appelle « structure psychique », même ce qu’on croit pouvoir décrire comme une « fixation ».
Pensons un instant à ceci: la physique nous apprend qu’il n’y a rien d’arrêté nulle part. Déjà en 1896, le philosophe Henri Bergson (in Matière et mémoire) avait avancé que les choses apparemment les plus stables et immobiles sont en fait des processus qui se répètent à très haute vitesse. On pourrait par conséquent dire que ce qui se présente à nous comme une « structure », au plus près donc d’une réification, d’une entité occupant de l’espace, n’est en réalité qu’un processus apparemment arrêté, mais plus exactement se répétant à une fréquence telle que nous n’en notons pas le mouvement. Quand, en 1914, dans « Remémoration, répétition et perlaboration », Freud s’est attardé pour la première fois sur la question de la répétition, un des exemples de répétition qu’il a donné, c’est le caractère d’une personne, donc la chose apparemment la plus fixe.
Cette idée de processus se répétant à grande vitesse pourrait cependant avoir l’air d’une ruse de l’intellect. On pourrait, par exemple, objecter que cela est indémontrable et que l’expérience concrète nous met bel et bien face à des entités stables, voire immobiles. Mais il n’en est rien. L’expérience concrète ne tombe victime de cette illusion que si elle ignore certains faits essentiels de l’expérience analytique, tels que la remémoration, la formation des rêves, le transfert et, comme je le propose dans mon texte, la fantasmatisation. Le transfert est un bon exemple pour illustrer combien la structure de personnalité apparemment la plus stable est en réalité mobile et combien rapidement elle se met à évoluer dans une direction différente dès qu’un analyste s’offre pour écouter.
Les considérations de Larry Friedman citées par Richard Simpson partent du même texte freudien de 1914; elles nous rappellent qu’il en va de même de la résistance et de la perlaboration. Déjà la perlaboration (Durcharbeitung dans l’original allemand; working-through dans la traduction anglaise) parle de travail (labor, Arbeit, work). Cela, c’est assurément du mouvement. Mais qu’en est-il de la résistance? Ne nous apparaît-elle pas avant tout comme une inertie, comme quelque chose d’arrêté ? Ce serait oublier ce que, dans ce même texte, Freud qualifie de plus grande forme de résistance, à savoir, la répétition dans le transfert ! Or un transfert, c’est tout sauf immobile! Les autres formes de résistance invoquées par Freud, sont la résistance de refoulement et la contrainte de répétition telle que formulée en 1919. La répétition, nous venons d’en parler. Quant à la résistance de refoulement, Freud dit bien dans les textes métapsychologiques de 1915 qu’il s’agit d’une dépense continuelle d’énergie. Donc, rien d’immobile ou d’inerte là non plus.
Si tout est mouvement, alors nous comprenons mieux, je crois, ce que Freud a pu vouloir dire quand il a parlé de « fiction » à propos de l’appareil psychique, ou de « mythologie » à propos des pulsions. La fiction ou la mythologie sont les modes par lesquels notre esprit essaie de se représenter ces choses qui, dans leur mouvement incessant seraient autrement insaisissables. Nous avons tous un impérieux besoin de nous représenter les processus, et pour cela nous avons tendance à les immobiliser, à faire ce qu’au cinéma on appelle « arrêt sur image » (en anglais: freeze-frame). Notre tendance à immobiliser l’objet de notre pensée, à le fixer afin de le maîtriser, est sans doute une constante. Cela porte d’ailleurs un nom dans la pensée freudienne: c’est la pulsion d’emprise (Bemächtigungstrieb), encore traduisible par « pulsion de pouvoir » 1. Il nous faut toujours faire un effort paradoxal pour contrer cette pulsion au-dedans de nous. Paradoxal, parce que cette pulsion est indissociable du besoin de comprendre, de littéralement « saisir », et que pour cela nous tendons à immobiliser l’objet de notre compréhension ou de notre saisie. Les philosophes ont depuis longtemps nommé ce processus: c’est l’hypostase. Ce terme dérive du grec, hypo (sous) et stasis (arrêt, pause); si on traduit mot à mot en latin, cela donne sub et stans… ce qui nous donne substantia, la substance. Selon le Vocabulaire technique et critique de la philosophie, de Lalande, hypostasier, au sens moderne, signifie « transformer une relation logique en une substance, au sens ontologique de ce mot » […] et plus généralement « donner à tort une réalité absolue à ce qui n’est que relatif ». (Lalande, op.cit. Vol. I, p. 428). Dans l’extrait de L’inconscient que nous avons étudié l’automne dernier, nous avons vu comment Freud semble chercher à éviter d’hypostasier l’inconscient: il décrit d’une part le mouvement qui de l’inconscient « monte » vers la conscience, mais par la suite il renverse la perspective et nous dit que si on regarde les choses du point de vue de la conscience, tout ce qui se présente est d’ordre pré-conscient. Je ne sais pas si on peut dire qu’il évite ainsi complètement le problème de l’hypostase de l’inconscient, mais on sait qu’il s’y reprend plus d’une fois. Et surtout, la qualification de fiction donnée à l’appareil psychique, ou de mythologie pour ce qui est des pulsions nous montre bien que Freud n’est pas dupe de sa propre tentation d’ « arrêter sur image » sa description des processus psychiques.
La pulsion d’emprise est donc, entre autres choses, un mouvement paradoxal; paradoxal, parce que ce mouvement se manifeste comme effort d’arrêter un processus pour en faire un objet fixe et l’examiner à son aise, pour en saisir le sens, pour le com-prendre. Il y a de la préhension dans la compréhension. La prise en question, Emmanuel Levinas souligne qu’elle entre aussi dans le savoir et dans la représentation: il s’agit de saisir, dans tous les sens du terme. Mouvement de saisie qui correspond aussi à l’établissement du moi et de l’identité.
« Dans le courant de la conscience qui constitue notre vie dans le monde, le moi se maintient comme quelque chose d’identique à travers la multiplicité changeante du devenir. Quelles que soient les traces que la vie nous imprime en modifiant nos habitudes et notre caractère, en changeant constamment l’ensemble des contenus qui forment notre être, un invariable demeure. Le “je” reste là pour relier l’un à l’autre les fils multicolores de notre existence.
Que signifie cette identité? Nous sommes portés à la considérer comme l’identité d’une substance. » (Levinas, De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, 1963, p. 148.)
Nous voilà donc revenus à la substance, à l’hypostase. C’est d’ailleurs ainsi que Levinas a intitulé la section de son livre d’où j’ai tiré la citation.
Levinas précise ensuite :
« Le “je” serait un point indestructible. dont émanent actes et pensées sans l’affecter par leurs variations et leur multiplicité. Mais la multiplicité des accidents peut-elle ne pas affecter l’identité de la substance? Les relations de la substance avec les accidents sont autant de modifications de cette substance, et dès lors l’idée de substance apparaît dans une régression à l’infini. » (Ibid.)
On voit tout de suite qu’il ne peut être question de substance que comme hypostase, comme transformation en substance de ce qui est mouvement, processus, changement permanent.
Levinas encore:
« C’est alors que la notion de savoir permet de maintenir l’identité de la substance sous la variation des accidents. Le savoir est une relation avec ce qui par excellence demeure extérieur, la relation avec ce qui reste en dehors de toute relation, un acte qui maintient l’agent en dehors des événements qu’il accomplit. L’idée du savoir — relation et acte hors rang — permet de fixer l’identité du « je », de le garder enfermé dans son secret. Il se maintient sous les variations de l’histoire qui l’affecte en tant qu’objet, sans l’affecter dans son être. Le « je » est donc identique parce qu’il est conscience. » (p. 148-149.)
Il est important de noter, en lisant ces lignes de Levinas, que ce qu’il décrit ici n’est pas « sa » position sur le je ou sur la substance. Il est en train de faire l’analyse phénoménologique de la chose, c’est-à-dire de suivre le mouvement même du « je » qui se pense comme substance. Il dit bien, quelques lignes plus loin, que cette conception substantialiste du moi est le fait de l’idéalisme. Et il conclut:
« Le je n’est pas une substance douée de pensée: il est substance parce qu’il est doué de pensée. » (p. 149, italiques ajoutés par moi)
À quoi on est tenté d’ajouter que le « est » dans « est substance » ne désigne pas une entité, mais une conception, un discours du je sur lui-même, il s’attribue une substance par la pensée. Cela, notons-le-, se retrouve aussi chez Piera Aulagnier:
« Le Je n’est pas autre chose que le savoir que le Je peut avoir sur le Je […] » (La violence de l’interprétation, PUF, 1975, p. 169.)
Une telle définition du Je est certes circulaire, mais, malgré les apparences, elle n’est pas tautologique. La circularité correspond à la nature autopoïétique de tout ce qui est vivant. L’autopoïèse est en effet par définition circulaire: le vivant n’est vivant que d’être autonome, de s’auto-instituer, de s’auto-délimiter en tant que système doté d’une clôture opérationnelle. Si un organisme particulier naît d’un autre organisme, il reste que le vivant ne peut que s’être auto-créé et ne peut que s’auto-entretenir. C’est là le sens d’un système autopoïétique. Il y a de l’auto-engendrement.
Chose intéressante, dans sa définition du Je, Aulagnier ne fait que reprendre au plan du « secondaire » (c’est-à-dire, celui du discours), un procédé analogue à celui qu’elle attribue à l’originaire, c’est-à-dire : l’auto-engendrement. Sauf que là où l’auto-engendrement est pour l’originaire un postulat indépassable et impossible à rendre en mots, le fonctionnement du Je, bien qu’il s’appuie, comme par décalque, sur une circularité semblable à celle de l’originaire, nécessite le recours au langage, puisque le Je est discours. Le Je est donc toujours déjà double: d’une part il s’auto-organise comme tout organisme vivant, mais d’autre part, sa nature secondaire signifie qu’il s’organise sur le modèle de l’autre, au moyen de l’identification à l’autre (image spéculaire). Il n’est donc pas totalement sous le postulat d’auto-engendrement, mais il y a tout de même une même reprise/dépassement (Aufhebung) de ce postulat (qui est, rappelons-le, caractéristique de l’originaire.) Par conséquent, on peut dire que le je s’auto-organise, mais qu’il n’est pas auto-engendré, puisque, toujours selon Aulagnier,
« le Je est formé par l’ensemble des énoncés qui rendent dicible la relation de la psyché avec ces objets du monde par elle investis et qui prennent valeur de repères identificatoires. » (Ibid. italiques ajoutés par moi).
Nous pourrions, bien entendu, nous avancer plus loin dans la discussion de cet aspect et il faudra sans doute le faire un jour. Pour le moment, je souligne surtout le fait que c’est le mouvement, le processus de la pensée et/ou du discours qui est l’essence du psychique, et cela autant chez Levinas que chez Aulagnier, de même que chez Freud, comme nous l’avons vu au début du présent texte. Mais un examen attentif — phénoménologique chez Levinas, métapsychologique chez Freud et Aulagnier — nous montre que le mouvement de la pensée est toujours aux prises avec la tendance à l’hypostase, à l’arrêt sur image, ou à ce qu’on pourrait appeler une sorte de « dévotion » envers la représentation.
Il y aurait lieu de parler ici d’une sorte de fétichisme, dont Derrida disait que c’est un penchant indépassable de l’humain. Or il est fascinant de constater que la théorie de l’origine du fétiche chez Freud se base précisément sur un moment d’arrêt du mouvement d’exploration par l’enfant de l’anatomie sexuelle. Ainsi, Freud postule que le choix du fétiche (talons à aiguilles, jarretelles, fourrure, etc. ) correspond souvent à la fixation sur la dernière chose qui s’est présentée à la perception juste avant le constat intolérable de l’absence de phallus sur le corps féminin… Notons combien cela s’apparente à la fixation sur un scénario fantasmatique, fixation qui a pu donner lieu à l’impression (que j’ai contesté dans l’article discuté à l’automne) que les fantasmes sont des entités bien formées et « contenues dans » l’inconscient.
(2016-10-24)
NOTES
- Voir l’article de René Major, Le goût du pouvoir, ajouté à la section « Documents ». ↩