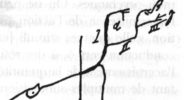Pour « l’être en question », un problème à résoudre est que les questions tendent à élever la tension psychique et donc à provoquer un déplaisir, d’où la tendance naturelle à trouver le plus tôt possible des réponses (principe de plaisir). Seul un entraînement prolongé, une longue expérience et une méditation patiente peut corriger la situation et faire en sorte que l’on donne priorité à la position « questionnante » et qu’on y trouve même du plaisir; mais cette position est toujours dérangeante et l’on sait que de grands questionneurs, tel Socrate, Giordano Bruno et bien d’autres l’ont payée cher.
L’émission d’une réponse quelle qu’elle soit, a tendance à abaisser le niveau de tension, et donc à être ressentie comme plaisante; d’où des solutions précipitées, des théories hâtives, des réponses parfois bâclées. Non qu’on puisse jamais totalement échapper à cette tendance, mais en tout cas il faut noter que rester du côté des questions plutôt que des réponses est plus fatigant et qu’il faut bien, de temps en temps, avoir l’impression d’avoir « trouvé ». On attribue à Picasso la phrase « Je ne cherche pas, je trouve », mais dans la mesure où cela est possible, « trouver sans chercher » peut signifier qu’en tant qu’artiste on peut se permettre de répondre à des questions qui sont demeurées inconscientes, et que ce sera le spectateur qui se posera (ou non) des questions devant l’œuvre; c’est l’œuvre qui nous interroge, nous spectateurs. L’artiste aurait donc trouvé… de bonnes façons de poser des questions non articulées en mots. Tandis que pour élaborer une pensée, il convient d’expliciter les questions et de les articuler de manière ouvertement partageable. Non que l’élaboration d’une pensée aboutisse seulement à des contenus manifestes : les grandes œuvres de pensée continuent de nous interroger, même après des siècles, et n’ont jamais fini de nous livrer de nouvelles façons de les lire. Que ce soit en art ou dans les œuvres de pensée, il faut travailler à non seulement poser les bonnes questions, mais aussi à les poser de la bonne façon. Pour l’artiste ce sera une affaire de formes plastiques, sensorielles. Pour le travail de pensée, il s’agit de trouver des formes d’expression qui stimulent la réflexion tou en veillant à ne pas l’égarer sur des chemins sans issue.
C’est, je crois, une façon de comprendre ce qu’exigeait Karl Popper à propos des hypothèses et théories scientifiques. Pour lui le problème n’est pas d’abord de savoir si une théorie est vraie ou fausse: à cela, l’expérimentation et la réflexion sur les résultats de l’expérimentation pourront répondre, même si de façon provisoire. Le problème que soulève Popper est plutôt de savoir si la théorie envisagée répond à une question bien posée. Selon lui, une question bien posée est celle dont la réponse peut en principe être réfutable, falsifiable. Par exemple, en science « Dieu existe-t-il ? » est une question mal posée, parce que la réponse, négative ou positive, n’est pas réfutable.
Contrairement aux scientifiques, les artistes, écrivains et créateurs ne sont pas soumis à ce critère de réfutabilité. Un artiste qui vient à la suite de Picasso peut apprendre les techniques picturales de celui-ci, mais il n’a pas accès aux questions implicites qui motivaient chez Picasso la production d’un tableau ou d’une sculpture, et de toute façon ce serait bien triste si cet artiste ne visait qu’à arriver aux mêmes réponses que le grand maître espagnol! Là où en science il s’agit, après avoir posé de bonnes questions, de pouvoir reproduire les résultats à l’identique pour s’assurer de leur validité, en art, la reproduction d’une œuvre de maître n’est tout au plus que la manifestation d’une habileté technique. Il y manquera ce que Walter Benjamin appelle l’aura propre à une œuvre originale1 L’aura, écrit Benjamin, « [o]n pourrait la définir comme l’unique apparition d’un lointain, si proche soit-il » (p. 278). Beaucoup de commentaires ont été écrits à propos de ce texte important de W. Benjamin, et je ne me risquerai pas à y ajouter le mien. J’ajoute cette référence pour mieux faire apparaître ce qui me semble la position originale de la psychanalyse, dans la ligne de pensée que je poursuis en ce moment.
Entre art et science, la psychanalyse, de par sa méthode et sa position métapsychologique, se situe en position autre: ni science au sens strict, ni seulement art. On pourrait dire que son caractères spécifique est celui d’une attention dirigée autrement que les sciences ou les arts. Ni attention dirigée et soutenue, comme il sied aux sciences vouées à la reproductibilité des résultats, ni pure créativité comme dans les arts. L’analyste ne travaille pas sur un objet dont on contrôlerait les variables et ne vise pas des résultats reproductibles. Dans ce sens elle semblerait tournée plutôt du côté de « l’unique apparition d’un lointain », de l’aura dont parle Benjamin. Cependant, il n’est pas possible non plus de faire valoir le travail analytique comme œuvre d’art. Cela parce que l’analyse se passe dans un rapport essentiellement privé, nullement destiné à l’exposition publique. Certains moments analytiques semblent pourtant dotés de cette aura, de cette « unique apparition d’un lointain » dont parle Benjamin. Mais on fait tous, je crois, l’expérience suivante: lorsqu’on essaie de raconter à d’autres ces moments analytiques uniques, on constate que leur aura s’est évanouie. La narration a beau être écrite de la plus belle plume – comme dans les histoires de cas de Freud –, elle ne reconduira pas l’expérience analytique en tant que telle, tandis que l’œuvre d’art, si l’on se donne les conditions propices pour la rencontrer, possèdera l’aura unique qui est la sienne et qui nous affectera, chacun différemment, en pointant vers « un lointain » dont nous pourrons plus ou moins obscurément témoigner.
*
Néanmoins, nous sentons, en psychanalyse, le besoin d’articuler de façon rigoureuse une théorie qui soit communicable à d’autres psychanalystes, qui puisse éclairer la pratique et stimuler une élaboration ultérieure. Pour cette raison, bien que ne nous réclamant pas des « sciences dures », nous ne saurions non plus prétendre jouir du privilège de Picasso, ou de tout autre artiste, et déclarer (comme l’a fait Lacan) que nous ne faisons que trouver.
Un aspect particulier à notre discipline est que la pratique nous amène des sujets dont les « réponses » tentées au cours de leur existence sont l’aspect qui nous est le plus accessible: réponses qui, du fait même que le sujet vient demander une analyse, doivent avoir été « insuffisantes » ou « inadéquates » face aux situations rencontrées jusque-là. Mais au fait, ces réponses ne seraient-elles pas problématiques avant tout parce que les questions qui les ont suscitées ne pouvaient pas être bien formulées ? Non que, dans notre existence, nous devions nous formuler des questions sujettes à réfutabilité ! La vie n’est pas une expérience scientifique ! Non, le problème est que nous sommes confrontés à des questions non-formulées, ou encore que nous héritons à la fois de questions obscures (qui ne sont pas formulées chez les émetteurs eux-mêmes) et de réponses toutes faites, de modèles, de manières de faire, de dire et de penser déjà constituées que tout nous pousserait à reproduire, si possible, à l’identique. Cela est observable tant dans la pratique avec des individus qu’au plan social. La psychologie de masse se caractérise, entre autres choses, par l’évitement de l’esprit critique, de la capacité de (se) poser des questions.
La production de réponses aux questions dont nous nous occupons est évidemment modulée par la position du sujet soumis aux dites questions. Revenons brièvement à la situation de l’infans, dans la mesure où, comme on sait, le mot même d’infans concerne, précisément, l’incapacité de parler, de formuler en mots questions et réponses. Quand la position de base de l’infans – son « going on being », comme le formule Winnicott – est perturbée par l’impact de ce qui vient de l’autre, on a vu au chapitre précédent que deux modalités principales s’ouvrent devant lui. Soulignons une fois de plus que ces deux modalités ne sont pas en réalité indépendantes l’une de l’autre et que seule une division artificielle par domaine de connaissance les distingue. La méthode analytique exige en effet d’exclure une de ces deux modalités afin de rendre l’autre plus opérante en cours de séance.
Il y a d’une part la modalité que nous disions éthologique, celle où des mécanismes élaborés au cours de l’évolution de l’espèce permettent un ajustement plus ou moins optimal entre l’infans et l’adulte qui en a soin: c’est, comme on l’a vu précédemment, le phénomène de l’attachement. Si l’on examine cette modalité séparément, on peut dire qu’elle comporte des questions pour lesquelles l’évolution aura déjà fourni sinon des réponses complètes, au moins des prototypes de réponses, l’expérience vécue par l’infans étant alors soutenue par les soins, la patience et la tendresse de l’adulte. À la question vécue par le nouveau-né en tant que « faim », il y a des réponses prévues du côté maternel. De même, côté mère, à la question: « Que suis-je pour cet enfant ? » le nouveau-né apportera bientôt des réponses sous forme de cris qui s’entendent comme des appels, etc. L’accordage (attunement) se fera progressivement, profitant de la complémentarité entre les prédispositions innées et l’apprentissage progressif par essais et erreurs. Ainsi, un nouveau-né est doté de certains mécanismes innés le portant à téter le sein (réflexe du rooting, p. ex.), mais toute mère aura fait l’expérience que cela ne fonctionne pas parfaitement au premier essai et qu’il faudra quelques jours d’ajustement avant que la chose semble aller de soi. Vues sous cet angle, quand tout se passe assez bien, questions et réponses semblent se succéder et se complémenter sans trop de problèmes. Tableau idéal, voire idyllique, mais en partie faux, puisque rien chez l’humain ne se passe au simple plan éthologique ou de l’attachement. La théorie de l’attachement elle-même a bien dû poser des styles d’attachement variés et parfois problématiques (attachement anxieux, évitant, ambivalent désorganisé, etc.), mais tout cela relève du plan psychologique des comportements observables.
L’autre modalité est celle du sexuel au sens psychanalytique du terme (Sexual, chez Laplanche). La prise en compte de cette autre modalité n’est pas une lubie théorique. Elle résulte de la considération – assez banale, mais aisément négligée – que la relation de l’adulte à l’enfant est de part en part traversée par un courant sexuel. Ainsi, pour revenir à la tétée, Laplanche demande: comment peut-on ignorer que le sein de la mère est non seulement un organe nourricier, mais un organe sexuel très investi par la mère ? Qui plus est, ajoutera de M’Uzan, le mamelon est un organe érectile dont la stimulation, y compris par la tétée de l’enfant, peut conduire jusqu’à l’orgasme. Mais attention : il n’est nul besoin que la mère éprouve un orgasme pour que la situation soit chargée de Sexual. Le plus important est ailleurs: c’est le fait que la mère, le père ou tout adulte qui interagit avec l’infans est aux prises avec un inconscient, c’est-à-dire avec son propre Sexual refoulé, fait de désirs et de fantasmes – cela, c’est l’expérience analytique qui nous l’apprend. Les interactions adulte-enfant ne peuvent manquer de solliciter quelque chose de ce sexuel refoulé de l’adulte, qui viendra s’immiscer dans la relation d’attachement, « contaminant », si l’on peut dire, les mécanismes adaptatifs de la modalité que nous avons qualifiée d’éthologique. On peut dire que ce courant est une façon de « passer » les questions de l’adulte à l’enfant; questions non-formulées en tant que telles, y compris chez l’adulte; transmission qui transcende les individus, les générations et les époques.
*
Je reviens ainsi, comme on voit, à la séduction au sens généralisé de Laplanche. Mais il y a lieu, comme annoncé la fois précédente, d’y ajouter des observations venant d’une autre théoricienne de la psychanalyse, Piera Aulagnier, qui s’est attardée à la relation mère-infans sous un autre angle. Dans un article intitulé « Demande et identification » 2, Aulagnier décrit avec minutie le va-et-vient entre besoin, désir et demande qui se produit entre mère et enfant. Avec des formules telles que « La mère désire que l’enfant demande », de même que par le constat que l’offre maternelle précède la demande de l’enfant, nous nous trouvons sur une voie qui, pour être parallèle à celle de Laplanche, décrit ce qu’on peut appeler l’aspect narcissique et identificatoire de la séduction. Mais on aurait tort, à mon avis, d’y voir deux lectures contrastées de la même situation. Ainsi, le désir de la mère que l’infans demande le sein n’inclut-il pas par définition son être sexué autant que son idéal d’être une bonne mère? Un idéal qui s’obtient par une désexualisation relative et la transformation du pulsionnel en libido narcissique. Sans utiliser ni le terme ni le concept d’attachement, Aulagnier montre que les mécanismes innés n’opèrent pas indépendamment de la dimension sexuelle, ni dans sa version directe (qui chez Laplanche se nomme séduction généralisée) ni dans sa version indirecte (désir d’être objet de demande; refoulement de ses propres désirs œdipiens, identification de l’enfant et besoin d’être identifiée par celui-ci, chez Aulagnier).
Ne manquons pas de noter également que dans les formulations de ces deux auteurs surgit nécessairement la dimension de la « question ». En effet, on a vu que chez Laplanche, l’expérience de l’infans – qui se trouve au pôle récepteur des messages compromis – pourrait se formuler ainsi : « Que me veut-il ? ». Dans la description faite par Aulagnier il est pareillement notable que le désir de la mère d’être l’objet de la demande de l’enfant relève de l’univers des questions, comme le mot « demande » le suggère : « Qui/que suis-je pour toi ? » en serait une formulation possible. Répétons-le, ces questions ne sont pas formulées verbalement, ni les réponses qu’elles suscitent d’ailleurs. Cette absence d’articulation verbale constitue déjà leur caractère non conscient, quoique pas nécessairement refoulé. Le refoulement, lui, viendra ensuite, en tant que l’avers des réponses qui seront tentées par l’infans; cela selon le modèle traductif introduit par Freud et que nous avons examiné. Ces traductions s’inscrivent d’une part comme des réponses, mais constituent aussi de nouvelles questions. Cela parce qu’aucune réponse finale ne peut être trouvée aux énigmes du désir de l’autre qui se présentent dans la « situation anthropologique fondamentale ». Situation caractérisée d’une part par la dissymétrie entre adulte et enfant: adulte doté d’un inconscient refoulé; enfant porté à traduire l’excès de sens véhiculé par le message compromis à l’aide des instruments que lui auront transmis les mêmes adultes-séducteurs malgré eux. Ces instruments incluent, avec le langage, les formes mytho-symboliques propres à la culture ambiante; ces formes opèrent des effets qu’Aulagnier nomme « violence primaire », formes qui viennent « informer » les vécus corporels, psychiques et relationnels de l’infans.
Ces formes traductives, faut-il noter, sont déjà elles-mêmes marquées par les refoulements propre à la culture qui les porte et ne sauraient donc offrir de traduction intégrale aux énigmes auxquelles l’infans est confronté. C’est ce qui fait que chaque traduction opérée par l’enfant opère en même temps un refoulement, par un échec au moins partiel de traduction. Nous nous trouvons ainsi devant un processus en spirale : un refoulement en entraîne un autre, et c’est sans doute ainsi qu’il faut concevoir la notion de refoulement originaire. Rappelons que le mot « originaire » ne signifie pas « premier » ; l’origine dont il est question dans ce concept c’est la réitération permanente du couple traduction/échec de traduction. Mais puisque la traduction incomplète n’est pas le seul fait de l’enfant – la culture elle-même manquant à donner à l’infans la possibilité d’une traduction intégrale – on en conclut que cet échec est inscrit dans le rapport fondamental individu/culture. C’est peut-être dans ce sens que l’on peut affirmer que le refoulement est « d’origine », « à l’origine ». Oserons-nous faire un pas de plus et déclarer que l’origine, c’est le refoulement ? Nous avions vu qu’il faut poser à l’origine le tracé d’une limite, d’une marque différentielle. Et Jacques Mauger avait alors signalé que c’est seulement à partir d’une limite qu’il est possible de penser l’illimité. On pourrait même dire que c’est du fait de la limite qu’il est possible de penser tout court. Tout cela mérite discussion et réflexion, mais affirmer la proximité, voire l’équivalence entre refoulement et originaire, n’est pas si surprenant si on s’accorde avec Freud pour dire que la théorie du refoulement est la pierre angulaire de la théorie psychanalytique. Ce statut de pierre angulaire peut s’entendre de deux façons : pierre angulaire parmi les autres « pierres » constitutives de la théorie, mais aussi, et peut-être surtout, pierre angulaire de la possibilité même de théoriser!
*
Difficulté de la question et trivialité des réponses
Chose intéressante, le philosophe Ludwig Wittgenstein a écrit que « la philosophie dénoue des noeuds dans notre pensée » 3. Devant une question difficile, qui nous taraude, on peut s’impatienter et tenter de « trancher le nœud », c’est-à-dire de « prendre un parti unilatéral », écrit Descombes en rapportant la pensée de Wittgenstein. Or : « la bonne méthode est de faire preuve de patience et de détacher les fils progressivement. On parvient alors à une réponse qui paraît triviale et qui, en effet, est triviale. Pourtant, si notre question était bien philosophique, nous ne sommes nullement déçus, car ce que nous cherchions n’était pas vraiment cette réponse (nous la connaissions déjà), mais un moyen de l’accepter comme bonne réponse. Et c’est justement cela que le noeud conceptuel nous empêchait de faire. La réponse est triviale, mais le chemin vers cette réponse ne l’est pas. » 4
Il me semble que c’est là une réflexion tout a fait applicable à la démarche psychanalytique.
Sur la question de la trivialité de la réponse, on pense ici à ce qu’écrit Freud dans « Remémoration, répétition et perlaboration » (O.C. vol. XII), quand il note qu’après une interprétation l’analysant déclare: « je l’ai à vrai dire toujours su, mais je n’y ai pas pensé » ( p. 188). La chose était donc connue, encore fallait-il y penser! Or qu’est-ce que « y penser » ? Sans vouloir nous précipiter vers une réponse globale, je propose que cela signifie entre autres faire le travail de dénouement des nœuds dont parle Wittgenstein. Cela n’est pas sans évoquer la question de la patience nécessaire à la perlaboration en analyse 5.
Il se trouve que le même Wittgenstein, que l’on présente souvent comme un ennemi de la psychanalyse, a nommément comparé sa façon de travailler à celle da la psychanalyse:
« Notre méthode ressemble en un sens à la psychanalyse. Pour le dire à sa façon, on peut dire qu’un élément à l’œuvre dans l’inconscient est rendu inoffensif par le fait d’être articulé. Et cette comparaison avec l’analyse pourrait être poussée plus loin. (Et cette analogie n’est certainement pas une coïncidence.) » 6
Que Wittgenstein compare sa méthode philosophique à la psychanalyse et dise que l’analogie n’est sûrement pas une coincidence et qu’elle peut même être développée davantage, cela devrait nous intéresser. Notons au passage sa claire compréhension du mécanisme par lequel c’est l’articulation de ce qui est inconscient qui rend ce dernier « harmless ». C’est là, j’ose dire, une bonne description du circuit qui part des « nœuds » pathogènes qui sont à défaire, pour parvenir à une articulation par/dans la parole. Sauf que ce circuit passe par la confrontation à « l’inconscient qui ne parle pas » 7 et qu’il ne s’agit pas de « faire parler » en tant que tel (cet inconscient restera inarticulable). Ce qui se passe, c’est qu’au moment où les réponses préexistantes sont « remises en question » ou si l’on veut « soumises à la question » par le travail d’analyse, le caractère in-fans (qui ne parle pas) de ce plan de l’inconscient se manifestera dans sa capacité à exciter et à déranger, forçant à produire de nouvelles « réponses ».
Je reviens à présent sur ceci, que ce qui est dit par Wittgenstein de la méthode philosophique ou psychanalytique se ramène en définitive à une description de ce que c’est que penser. Pour Aristote, la capacité d’étonnement est aux sources de la pensée. Le regard étonné que l’on peut porter sur le monde familier, on peut appeler cela, me semble-t-il, la remise en question de ce que l’on croit acquis, voire banal. Penser, c’est penser à nouveau, et pour qui craint de verser ainsi dans l’intellectualisme ou dans la pure abstraction, rappelons qu’il n’y a pas de pensée digne de ce nom qui soit exempte d’investissement libidinal 8. Par conséquent, la méthode analytique n’est rien d’autre qu’une méthode de pensée, une méthode pour parvenir à penser, c’est-à-dire non pas tant trouver des réponses que poser de bonnes questions, se les poser de la bonne manière. C’est ce qui nous permet d’affirmer par ailleurs l’étroite solidarité entre la méthode analytique employée en séance et la métapsychologie que nous mettons au travail pour penser après-coup l’expérience psychanalytique.
- W. Benjamin (1939) « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », in Œuvres, Vol. III, Paris, Gallimard, Coll. Folio Essais, p. 269-316. ↩
- in Un interprète en quête de sens, Paris, Rivages, 1986. ↩
- Cité par Vincent Descombes in Le complément du sujet, Paris, Gallimard, 2004, p. 11. ↩
- Descombes, op. cit. p. 12. ↩
- Voir le texte de J. André dans la section « documents ». ↩
- « Our method resembles psychoanalysis in a certain sense. To use its way of putting things, we could say that a simile at work in the unconscious is made harmless by being articulated. And this comparison with analysis can be developed even further. (And this analogy is certainly no coincidence.) » Ludwig Wittgenstein, Diktat für Schlick 28, Cité dans : Wittgenstein, Key Concepts. Sous la direction de Kelly Dean Jolley, Routledge, 2014. ↩
- Nous… parlerons de cet aspect dans un prochain texte. ↩
- Fait corroboré du point de vue neuroscientifique par les travaux d’Antonio Damasio rapportés dans son livre L’erreur de Descartes (Paris, Éd. Odile Jacob, 1994). ↩