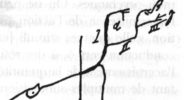La psychologie de masse, je rappelle pour ceux qui y étaient que nous en avons discuté il y a environ deux ans. Mais il vaut la peine de s’y attarder encore, puisque notre époque est, à ce sujet, riche de phénomènes qui s’y rapportent. Du fait des moyens actuels de communication, il est possible à tout individu, du moins en principe, de rejoindre une vaste quantité de gens à travers le monde et de diffuser sinon des idées, du moins des slogans, des bribes d’idéologie ou de doctrines politiques qui entraînent parfois, comme l’expérience hélas le montre, des tragédies à petite ou à grande échelle.
Dans son texte de 1921, Psychologie des masses et analyse du moi, Freud a conclu que ce qui caractérise la psychologie de masse, c’est de reposer sur ce qu’il appelle le « lien érotique », par opposition à l’usage de la raison et à l’application du principe de réalité. Cette notion de « lien érotique » est à préciser. Dans cette expression, notons qu’avec les mots « lien » et « érotique », nous sommes du côté du liant: cela va de soi avec « lien », mais c’est tout aussi vrai avec « érotique », puisque la nouvelle formulation du sexuel qu’invoque Freud après 1920, c’est Éros, le créateur de liens. L’Éros, dans le contexte théorique de 1920, relève d’une libido pour ainsi dire apprivoisée, ayant perdu le caractère pulsionnel du fait d’être investie de façon assez stable dans le moi (théorie du narcissisme).1
Dans le même ouvrage, Freud montre qu’à la faveur de l’immersion des sujets dans une foule ou une masse, leur moi se révèle porteur de fonctions qui pourraient autrement passer inaperçues. Une de ces fonctions, c’est l’idéal du moi, que Freud avait déjà repéré dans son étude de 1914 sur le narcissisme. Narcissisme et idéal du moi ont partie.. liée, et c’est à travers eux que se constitue le lien érotique qui régit la constitution d’une masse avec sa psychologie particulière. Le lien érotique se construit à travers les identifications qui opèrent tant en sens vertical (les membres d’un groupe ont adopté le même objet comme idéal) que transversal (les membres du groupe s’identifient les uns aux autres du fait de leur idéal commun).
Pourtant, on a vu qu’en fonction de la conception autopoïétique du vivant, il y a de bonnes raisons d’affirmer qu’un « fossé solipsiste »2 isole chacun des membres d’une masse avec une construction de sens qui lui est propre et qui n’est pas intégralement communicable. Le propre de la psyché est de construire du sens. C’est ce qu’on appelle la subjectivité, avec son caractère très variable d’un sujet à l’autre. Or on a l’impression que la constitution d’une masse ayant en partage un même objet idéal – un même leader ou une même cause – cela infirmerait, voire démolirait l’idée de fossé solipsiste. Est-ce bien le cas ? Je crois que non, mais cette apparente exception nous oblige tout de même à préciser notre modèle des systèmes autopoïétiques et de la transduction qui opère à leurs frontières.
Prenons, par exemple, le moi comme système. Alors nous discernons deux environnements:
1- L’environnement le plus proche, c’est l’inconscient, le refoulé avec ses poussées pulsionnelles, ses effets déstabilisants contre lesquels le moi se défend comme il peut quand l’énergie pulsionnelle ne peut pas être liée, canalisée, domestiquée pour ainsi dire. Ce qu’on appelle « mécanismes de défense » s’apparente à la notion de « couplage structurel » dont nous avons déjà fait mention (bien que ce rapprochement serait à examiner de plus prés). Cela parce que ces défenses permettent au moi de transiger avec le pulsionnel tout en y résistant. Le moi cède en quelque sorte du terrain à l’inconscient (les défenses fonctionnent en effet selon les modalités de l’Ics), mais c’est le prix à payer pour maintenir sa structure dans un état suffisamment stable.
2-L’autre environnement est fait des autres « moi », et la formation d’une masse indique bien que chacun des « moi » trouve une façon de se lier aux autres « moi ». De quelle nature est, dans ce cas, le « couplage structurel » qui permet cette liaison ? Freud parle d’identification, et il parle en même temps de « lien érotique ». Il n’y a pas de contradiction entre ces deux termes, puisque l’identification est en effet de l’ordre de l’Éros, créateur de liens, donc de l’ordre de la libido plus ou moins domestiquée. Je dis « plus ou moins domestiquée » parce que nous avons quand même affaire à un système vivant dont, par conséquent, l’énergie ne saurait être complètement liée. Une liaison totale, en effet, signifierait la mort psychique. Le lien identificatoire signifie que chaque moi dit aux autres « nous sommes semblables ». La réunion en groupe des « moi » ayant un important trait commun, c’est un autre bon exemple de « couplage structurel » : le trait commun à tous les membres du groupe est semblable à un fil qui les relie entre eux (couplage) et qui donne ainsi lieu à une nouvelle structure (le groupe). Le couplage structurel est donc, dans ce cas, constitué par le lien érotique/identificatoire – c’est-à-dire fait d’un Sexuel atténué, voire, selon Freud, « désexualisé ».
*
Note en passant
Il est intéressant de rappeler que cela concorde avec la conception du neurophysiologiste W.J. Freeman qui observe, au plan cérébral, un « fossé solipsiste » propre à chaque sujet dans sa perception du monde environnant. Devant ce constat, Freeman se pose aussi la question suivante : comment alors la communication est-elle possible, comment une compréhension du monde humain environnant est-elle réalisable ? Sa réponse ne suit pas un chemin direct. Pour Freeman, tout nouvel apprentissage, toute nouvelle compréhension nécessite d’abord un « désapprentissage » (« unlearning »), c’est-à-dire qu’il faut d’abord défaire les constructions existantes avant de pouvoir en faire de nouvelles. Cette notion est essentielle selon lui, et cela ne nous contrariera pas, nous qui, par l’analyse, procédons quotidiennement à la déconstruction de ce que nos analysants portent en eux afin qu’ils puissent reconstruire autrement. Chose encore plus frappante encore, pour cet « unlearning » (dont je rappelle que Freeman l’étudie au plan strictement cérébral, physiologique), eh bien, dit-il, les cerveaux ont besoin de… sexe ! De sexe, c’est-à-dire – puisque Freeman nous parle en biologiste – d’activité sexuelle, avec sa cohorte d’événements hormonaux. La décharge hormonale orgasmique est un exemple. Un autre exemple concerne ce qui se produit quand un animal comme la brebis met bas, et qui efface chez elle la mémoire des portées précédentes, permettant la création de liens avec la nouvelle portée… Nous sommes ici, rappelons-le, dans le domaine de la neurophysiologie. 3 Dans le domaine social, il est clair qu’il s’agit d’un sexuel nécessairement « inhibé quant au but », selon l’expression de Freud, sans quoi il n’y aurait pas de durabilité du lien social. En effet, sans prétendre à une quelconque correspondance harmonieuse entre la neurophysiologie cérébrale et la psychologie de masse, il est tout de même intéressant de noter que pour Freud, ce qui tient la masse ensemble, à l’opposé d’un lien sous-tendu par la raison ou la pensée critique, c’est le lien sexuel, mais atténué. Poursuivant le parallèle avec Freeman, on peut avancer que l’adhésion à un groupe, surtout si ce groupe prétend à une forte homogénéité, passe en effet par une sorte de « désapprentissage » au point d’exiger de l’adhérent qu’il renonce à plusieurs aspects de sa vie antérieure : les rites initiatiques dans certains groupes ou sociétés s’accompagnent parfois même d’un changement de nom (pensons aux conversions religieuses, aux « born again », au baptême chrétien: p. ex. Saul de Tarse s’appellera Paul après sa conversion…). 4
*
Avec ce détour par le lien érotique qui assure la formation d’un groupe, nous sommes amenés à nous demander si dans la formation d’un groupe le solipsisme a été aboli. Je ne crois pas, pour au moins une raison : c’est que rien ne nous permet d’affirmer que, dans un même groupe, les identifications à l’œuvre chez le sujet A sont exactement les mêmes que celles du sujet B. Même une enquête sociologique minutieuse manquerait à assurer que sous les mêmes mots logent des conceptions identiques d’un individu à l’autre. L’invérifiabilité (ou la non-falsifiabilité) fondamentale de ce qui est subjectif frustre toute tentative de connaître objectivement les identifications en question. La formation de factions, avec leurs luttes parfois fratricides, au sein d’un groupe arborant pourtant la même « philosophie » officielle, est une des conséquences de cette invérifiabilité. Les dénonciations et condamnations pour hérésie, pour révisionnisme ou déviationnisme au sein d’églises, de partis politiques (ou même, hélas!, d’associations de psychanalystes) – ayant souvent des conséquences graves –, les dogmatismes qui en sont la source, montrent bien que la cohésion d’un groupe ne repose pas sur des arguments vérifiables par une quelconque méthode « objective ». Les luttes intestines sont en définitive des luttes entre des subjectivités assemblées en sous-groupes où le « lien érotique » est plus fort que celui qui régit le rapport au groupe plus large.
*
Mais on peut pousser un peu plus loin la réflexion sur le lien érotique au sein du groupe si, dans la ligne de pensée de Luhmann, nous considérons qu’un groupe n’est pas composé par des individus assemblés. Cela, parce que le groupe est lui-même un organisme vivant, de nature autopoïétique, ayant ses propres lois de fonctionnement, et que, vus sous cet angle, les individus qui s’en réclament font partie de… l’environnement du groupe ! Ainsi, pour Luhmann la société n’est pas composée d’une somme d’individus… Elle est un système autonome auquel des individus (ou mieux: des systèmes individuels) se connectent dans un rapport système/environnement. Ce qui les connecte, c’est leur rapport à la communication, à la construction du sens. On obtient alors ceci: le système appelé société est organisé autour d’un certain nombre de postulats; les individus qui s’en réclament doivent pourtant interpréter chacun pour soi ces postulats, les adopter chacun à sa façon, sans jamais pouvoir prétendre à un rapport vraiment identique entre chacun d’eux et le système social. Que devient alors lien érotique qui, selon Freud, cimente l’organisation des groupes?
En tentant de nous approcher d’une réponse à cette question, rappelons qu’il s’agit toujours d’un lien où le mot « érotique » désigne un sexuel inhibé, atténué. Le groupe, ou la société dans son ensemble, en tant que société organisée, productrice de culture, repose nécessairement, selon Freud, sur un « renoncement pulsionnel ». Le Sexuel doit donc être désexualisé pour pouvoir contribuer à ce lien qu’il appelle « identification ». Remarquons au passage la proximité de l’approche freudienne de la psychologie de masse avec la pensée systémique de Luhmann: dans Psychologie des masses et analyse du moi, Freud ne prétend pas faire une « psychanalyse des masses » ; il s’en tient, en ce qui les concerne, au mot « psychologie », réservant le mot « analyse » au moi seulement. Cette analyse (décomposition) du moi, c’est ce qui est rendu possible par les modifications qu’entraine l’examen du moi individuel dans son rapport avec la masse ou le groupe. Il ne s’agit donc pas d’étudier l’individu comme « composante » d’un groupe, mais de considérer ce qui se passe dans le système appelé « moi » quand celui-ci est en rapport avec le système appelé « groupe ». Dans le langage des systèmes autopoïétiques, il s’agit de décrire les effets du couplage structurel entre individu et groupe sur un de ces deux systèmes, le moi. C’est cela qui intéresse avant tout Freud. Ce qui ne l’empêche pas de décrire le comportement des masses elles-mêmes. Mais on voit bien que même dans ce cas, et même sur la seule base des descriptions de Gustave Le Bon, la masse est considérée non comme une somme d’individus, mais comme une unité ayant ses propres lois internes. Encore faut-il distinguer entre diverses sortes de masses, foules ou groupes. Ainsi, une masse spontanée et temporaire, sans leader, ne fonctionne pas comme comme une masse avec leader, et encore moins comme un groupe organisé avec des statuts, un organigramme et des règles de délibération. À mesure qu’on avance de la masse informe à la société organisée, l’aspect « système » devient plus évident. Néanmoins, même une foule spontanée a son « individualité », si l’on peut dire, et se comporte en organisme unique, autonome. La description par Émile Zola des masses de mineurs en grève dans Germinal m’est venue en mémoire :
« … les hommes déboulèrent ensuite, deux mille furieux, des galibots, des haveurs, des raccommodeurs, une masse compacte qui roulait d’un seul bloc, serrée, confondue, au point qu’on ne distinguait ni les culottes déteintes, ni les tricots de laine en loques, effacés dans la même uniformité terreuse. Les yeux brûlaient, on voyait seulement les trous des bouches noires, chantant La Marseillaise, dont les strophes se perdaient en un mugissement confus, accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure. Au-dessus des têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa, portée toute droite; et cette hache unique, qui était comme l’étendard de la bande, avait, dans le ciel clair, le profil aigu d’un couperet de guillotine. » 5
Demandons-nous à présent, au vu du solipsisme, par quel moyen peut se maintenir le « trait commun » identificatoire, le lien érotique. Comment des sujets solipsistes, mais se réclamant d’un même groupe, peuvent-ils avoir ne serait-ce que l’impression d’être partie prenante d’une même entité ? La réponse, je crois, se trouve du côté sémiotique, ou si l’on préfère, du côté de la communication, du langage au sens large. Les sujets individuels utiliseront en effet les mêmes signes, les mêmes codes; ils se reconnaîtront entre eux par ces signes, ils en feront leur étendard. La hache, dans le passage cité de Germinal, est un exemple. Et nous voyons que Zola ne parle pas de celui qui la porte. C’est la hache qui passe, comme par elle-même. La notion d’étendard nous intéresse à plus d’un titre. On peut la rapprocher de celle d’emblème. Une foule porte (ou est portée par) un étendard comme « signe de ralliement » (Le petit Robert); un individu, lui, a pour équivalent un emblème ou une insigne.
Piera Aulagnier utilise le terme d’emblème pour nommer les repères identificatoires. Elle écrit:
« La valeur et la fonction identificatoire de ces emblèmes requièrent le consensus de l’ensemble ou du sous-ensemble auquel appartient le sujet. La valorisation de l’emblème par le seul sujet dépossède, dans ce cas, l’emblème de sa valeur de repère identificatoire. […] Nous dirons que le registre imaginaire définit l’ensemble des énoncés ayant la fonction d’emblèmes identificatoires et l’image spéculaire qui doit leur servir de point d’ancrage. » (V.I. p. 211.)
D’une part, donc, les emblèmes en question sont de l’ordre de l’imaginaire et d’autre part leur point d’ancrage est l’image spéculaire. Nous sommes donc on ne peut plus clairement dans le domaine du narcissisme et ses rapports avec les fonctions d’identification qui servent à signifier l’appartenance à un ensemble ou sous-ensemble (société, groupe, famille). Aulagnier parle ici de la constitution de l’identité plus ou moins stabilisée du sujet individuel au sein de son groupe d’appartenance:
« Ces emblèmes se présentent au Je comme identiques à ses “avoirs”: “avoirs”, à leur tour, définis par le message qui, à partir d’eux, revient au sujet pour lui dire “qui” il est. Être pareil à l’image qu’admire le regard des autres, ou être pareil à l’image qu’admire le regard de ceux que le Je admire sont les deux formulations qu’emprunte le vœu narcissique dans le champ de l’identification. » (ibid.)
On conçoit bien, par ces remarques, toute l’importance de ces repères imaginaires pour la constitution du Je au sein du groupe ou famille d’origine. Mais on imagine ensuite combien l’engagement dans des ensembles plus transitoires (parti politique, groupe religieux, par exemple) peut s’avérer fragile et donner lieu à des vacillements aussitôt que se profile une crise de confiance dans la capacité de ces groupes de confirmer la valeur de leurs emblèmes identificatoires. La subjectivité se révèle alors dans sa dimension d’invérifiabilité, dans la mesure où la vérification ne tient après tout qu’à un consensus qui n’a de validation que conventionnelle. Pourtant, ce genre d’adhésion est de nature à créer des groupes et des mouvements qui font ou changent l’Histoire, alors même que leurs fondements matériels (économiques, de survie) auraient pu prendre bien des formes variées.
*
Même si l’interprétation intime, subjective des signes de ralliement varie d’un sujet à l’autre, il reste que la perception d’un même élément de l’environnement se reflète – comme Freeman l’a démontré à sa façon – dans un « noyau » perceptif commun entouré d’un halo variable. Observation à nouveau très parlante pour tout lecteur du Projet de Freud, où celui-ci décrit un « complexe de perception » constitué d’une partie constante (la Chose, das Ding) et d’une partie variable (les attributs ou le prédicat).
Si on revient aux membres d’un groupe, on ne peut donc jamais savoir exactement de quoi est faite leur version subjective des emblèmes qui servent à l’identification, ce qu’ils ont investi selon l’Éros, mais la référence commune à des signes extérieurs – des signes qui circulent entre les membres, des mots d’ordre qui peuvent être repris par chacun et propagés aux autres – nous permet de comprendre que, malgré les malentendus inévitables, ils croient légitimement parler de la même chose. Les problèmes commencent quand les individus ignorent ou nient l’existence de ces possibles malentendus. Ce n’est pas un hasard si la cohésion d’un groupe se soutient de la circulation d’énoncés, d’opinions, de slogans, de mots à la mode, de tendances propagées par les institutions diverses, dont il importe peu qu’ils peuvent changer avec le temps, pourvu qu’ils soient repris par une majorité ou une part du groupe suffisante pour faire pression et entraîner les autres à y croire également. Le verbe croire est ici utilisé exprès, puisque l’adhésion à un groupe est synonyme de la croyance à un même idéal, à une même cause. Cette croyance est à la base de l’illusion groupale, mais il convient de souligner que les effets de cette illusion ne sont pas, eux, illusoires.
Le recours aux signes est essentiel, puisque, comme indiqué, ces signes (indices, icônes et symboles, selon la trilogie de Peirce) procurent à la communauté des subjectivités une base apparemment vérifiable. Mais l’usage de ces signes n’échappe pas au problème de l’invérifiabilité quant au fait de savoir si deux usagers entendent la même chose dans un signe identique. Pour prendre un exemple simple: en opposition à un régime autoritaire, le mot « liberté » peut mobiliser de larges masses dans un combat commun, mais on réalisera après coup que pour les uns il s’agissait de la liberté d’entreprendre, pour d’autres de la liberté politique (qui peut viser à limiter la liberté d’entreprendre), pour d’autres encore de la liberté sexuelle, ou de l’absence de toute contrainte sociale etc. Cette polysémie est un fait banal, mais ce fait concerne tout particulièrement les psychanalystes au travail, dans la mesure où il rappelle l’inévitabilité (ainsi que l’utilité, mais ce sera à discuter une autre fois) du malentendu en analyse. Ce fait inévitable en analyse devrait orienter notre attitude quant aux interprétations et aux constructions faites en cours de séance. En effet, le « fossé solipsiste » n’existe-t-il pas aussi entre analyste et patient ? Comment prétendre alors que ce que l’analyste entend de son patient, ou ce qu’il dit à celui-ci, pourraient avoir une correspondance exacte et vérifiable ? Freud, dans son texte de 1937, avait bien indiqué que l’accord ou le désaccord explicite entre analyste et analysant n’avait aucune valeur de preuve.
La finalité d’une analyse serait-elle donc d’atteindre simplement une sorte d’adhésion consensuelle, d’établir une narration plausible de l’histoire de l’analysant et de ses achoppements? Dans le texte de 1937, Freud semble aller dans ce sens, si l’on se fie à l’exemple qu’il donne lui-même d’une construction:
« Jusqu’à votre enième année vous vous êtes considéré comme le possesseur absolu et unique de votre mère; à ce moment-là, un deuxième enfant est arrivé et avec lui une forte déception. Votre mère vous a quitté quelque temps et, même après, elle ne s’est plus consacrée à vous exclusivement. Vos sentiments envers votre mère devinrent ambivalents, votre père acquit une nouvelle signification pour vous, et caetera. » (OCP, vol. XX, p. 65.)
Mais il faut noter que, dès la phrase suivante, il qualifie les constructions de « travail préliminaire » et qu’il dira plus loin que la construction isolée n’est « rien d’autre qu’une supposition qui attend examen, confirmation ou rejet. » (p. 69); plus loin encore: « La voie qui part de la construction de l’analyste devrait se terminer dans le souvenir chez l’analysé » (ibid.) à quoi il précise aussitôt : « elle ne va pas toujours aussi loin. » Freud dit alors que souvent on doit se contenter des constructions avancées par l’analyste mais que si l’analyse est bien conduite il résultera chez le patient « une conviction assurée de la vérité de la construction, ce qui du point de vue thérapeutique a le même effet qu’un souvenir recouvré » (p. 69-70).
L’explication que donne alors Freud n’est simple qu’en apparence et suppose que l’on ait examiné un certain nombre d’autres prémisses, par exemple celle concernant l’effet thérapeutique du soi-disant « souvenir recouvré ». Cela parce que Freud a déjà examiné ce problème plus de vingt ans auparavant et qu’une lecture d’autres écrits – notamment: « Sur les souvenirs de couverture » (1899) ou « Remémoration, répétition, perlaboration » (1914) – nous laisse interrogatifs devant la notion de « souvenir recouvré ». Cette question demanderait une longue digression par rapport à notre propos. Je la soulève pour attirer notre attention sur le problème suivant, dont Freud n’ignorait pas l’importance: le couple analytique peut tout à fait se comporter comme une « foule à deux », et toute la question est alors de comment éviter cet aspect de « psychologie de masse » pouvant surgir au sein même d’une entreprise censée nous dégager d’un tel effet.
La fin de l’article de 1937 que je viens de citer nous donne cependant le sentiment que Freud n’est pas dupe du danger des constructions qui se substituent au souvenir; ni peut-être de la signification de l’expression « souvenir recouvré ». Son propos se tourne en effet vers une sorte de souvenir qui a toutes les allures d’une hallucination, chez des sujets qui ne sont, dit-il, certainement pas psychotiques. Ce qui relance, selon moi, toute la question des fondements et des possibilités de l’expérience analytique, autrement dit de ce qu’est un véritable facteur mutatif dans l’analyse, et dont il n’est pas sûr que ce soit l’interprétation ou la construction en elles-mêmes, mais bien leurs soubassements économiques.
- Comme on sait, la fonction déliante, démonique, qui était auparavant attribuée à la pulsion sexuelle, Freud l’attribue désormais à la pulsion de mort. ↩
- Voir la section 4C. On pourrait aussi parler de fossé subjectif. ↩
- W.J. Freeman, Societies of Brains. A study in the neuroscience of love and hate. Hillsdale N.J. Lawrence Erlbaum, 1995. ↩
- Il n’empêche que la nature érotique du lien au groupe – ordinairement inhibée, atténuée – se révèle parfois bruyamment… sexuelle tout court, faisant éruption en des pratiques carrément orgiaques au sein de certaines sectes. Tou comme les rites carnavalesques qui se produisent dans toutes les sociétés, il s’agit là d’une surchauffe temporaire des liens au sein du groupe, un « désapprentissage » bientôt suivi d’une re-consolidation des liens. ↩
- Émile Zola, Germinal, Édition « Le livre de poche », p. 333-334. ↩