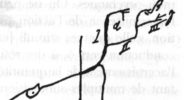En souhaitant à tous une très bonne rentrée, je me permets de vous livrer quelques réflexions introductives à l’orée d’un nouveau trimestre. Je vous propose de continuer à explorer cette notion d’hallucinatoire que nous n’avons qu’effleuré jusqu’à présent, me semble-t-il. Non qu’il faille absolument vouloir aller au fond de la question, si fond il y a, mais cette année j’a pensé qu’il serait intéressant de lier encore plus clairement notre étude « conceptuelle » à des problèmes plus manifestement cliniques. Notez que je considère que tout ce que nous avons fait jusqu’ici est déjà d’une très grande pertinence clinique. Parler de clinique, en effet, ne consiste pas nécessairement à rapporter « un cas », mais bien à poser le plus clairement possible les repères grâce auxquels on sait à peu près ce qu’on est en train de faire. C’est un vieux débat que celui entre les tenants d’une « clinique-clinique », c’est-à-dire qui se méfient de la théorie comme d’une teigne, trouvant que celle-ci n’est qu’une abstraction superflue, et ceux qui leur répondent qu’on ne saurait se passer de théorie et qu’en fait, ceux qui pensent ne pas en avoir une en font quand même usage à leur insu, et donc… en usent mal.
J’écris cela au moment où je viens de recevoir la nouvelle de la création d’un groupement nommé Radar-Psy (Réseau d’action et de défense des approches relationnelles en psychothérapie), réseau qui vise à fédérer les praticiens de la psychothérapie dans la mesure où celle-ci est basée sur la relation plutôt que sur une position d’expertise, par exemple. Personnellement j’applaudis à ce regroupement, même si en feront sans doute partie des praticiens dont je ne partagerais ni les prémisses théoriques ni la façon de travailler. Je suis favorable à ce regroupement dans la mesure évidemment où il veille à défendre une conception de la psychothérapie dans laquelle les psychanalystes peuvent reconnaître une base minimale d’accord concernant à leur propre pratique. En insistant sur l’approche relationnelle, Radar-Psy me semble offrir une telle base même si, bien entendu, le mot « relationnel » en psychanalyse n’a probablement pas le même sens que dans d’autres approches, et si la « psychanalyse relationnelle » américaine est devenue une approche spécifique dont il y a lieu de discuter vigoureusement les prémisses et la pratique. Il reste que, à un observateur extérieur, la pratique psychanalytique se présente en effet comme fondée sur la relation qui s’établit entre analyste et analysant, et que l’on peut, si l’on y tient, parler de « relation transférentielle », par exemple. Par ailleurs, il s’agit avec l’approche relationnelle, de contrer le scientisme et le culte irraisonné des « données probantes », ce qui est aussi une initiative digne de soutien.
Le risque d’une telle approche fédérative serait de laisser entendre que « nous faisons tous la même chose » (ce que, heureusement, les fondateurs de Radar-Psy se gardent de faire). Une visée trop œcuménique, en effet, aurait tôt fait de nous immerger dans une conception « molle », au sens où seraient perdus de vue certains principes et repères essentiels à la rigueur clinique nécessaire. Déjà que, dans les rangs même de la psychanalyse, on ne peut s’assurer de cette rigueur que par un débat incessant entre nous, une prise de parole qui nous permette d’intuitionner — à défaut de « vérifier » de manière intrusive — de quel bois se chauffent ses praticiens.
Or comment tenir des échanges valables et productifs entre psychanalystes — sans même parler du débat avec d’autres approches — si nous ne disposons pas d’un certain nombre de concepts et de théories suffisamment bien articulées pour pouvoir les mettre en discussion sans tomber dans la confusion ? C’est là, me semble-t-il, que le travail que nous menons dans notre séminaire prend toute sa signification. Si je vous propose de « penser avec Freud », c’est que, bien entendu, à l’intérieur même de la psychanalyse, chacun pourrait mettre de l’avant ses références privilégiées, dans un joli brouhaha de concepts (ceux de Bion, Klein, Lacan, Green, Laplanche, Winnicott, Aulagnier, et d’autres). Toutes références respectables, il va sans dire, mais dont on a vite fait d’oublier que leur œuvre s’est construite en dialogue ou par différenciation progressive d’avec la pensée de Freud. Ce qui signifie que l’on peut rater sensiblement le sens de leur contribution si on ne connaît pas suffisamment l’œuvre à partir de laquelle ces auteurs se sont mis à penser.
Par ailleurs, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, je ne crois pas qu’aucun des auteurs post-freudiens puisse être vu comme ayant supplanté Freud. Certains lacaniens diront cela de Lacan, certains bioniens se passent allègrement de toute référence à Freud, mais il faut noter que Lacan, par exemple — même si c’était peut-être pour des raisons politiques — a un jour déclaré à ceux qui le suivaient: « Soyez lacaniens si vous voulez; moi, je suis freudien ». Or, quelles qu’aient été les intentions de Lacan, je crois qu’il faut prendre cette déclaration à la lettre et affirmer sans hésiter qu’on ne peut vraiment se servir de Lacan ou de quelqu’autre post-freudien sans avoir auparavant suffisamment fréquenté la pensée de Freud. Et fréquenté, il va sans dire, les yeux ouverts, l’arme de la critique à la main. J’ai déjà indiqué que je mettais Laplanche un peu à part, puisque celui-ci s’est consacré justement à soumettre l’œuvre de Freud à un travail critique mené avec les outils freudiens. Mais même dans le cas de Laplanche il faut nécessairement avoir une connaissance de première main de l’œuvre de Freud pour en apprécier le réexamen.
La maxime que j’ai adopté pour ma part est celle-ci: faisons le plus de chemin possible en compagnie de Freud et ne recourons aux post-freudiens que lorsque ceux-ci jettent une lumière nécessaire là où persistent des obscurités. Or des obscurités, des difficultés théoriques et des contradictions, il y en a assurément chez Freud. Mais pour les voir et les retravailler, il faut encore recourir à Freud, puisqu’elles se terrent nécessairement dans l’ombre engendrée par la la lumière qu’il a produite.
Hallucination et conscience (de soi)
Définir les termes…
En faisant des excursions en dehors du champ strictement psychanalytique, on est parfois porté formuler quelque peu différemment des questions que l’on aurait cru résolues depuis longtemps. Ainsi, à propos du premier modèle topique (Inconscient/préconscient/conscient), les nombreuses recherches et réflexions des dernières décennies sur la conscience (ou, si l’on veut, le conscient) nous obligent à nous demander ce que l’on entend par ce terme en psychanalyse.
Soulignons d’emblée que la question de la conscience est très vaste et complexe; elle est de plus rendue parfois confuse par un usage ambigu des termes. Ainsi, on peut parfois entendre le terme conscience comme désignant la conscience morale, le sens de responsabilité, voire de faute, comme dans « avoir quelque chose qui pèse sur la conscience ». En ce qui nous concerne ici, nous mettons de côté cette acception du terme, quitte à y revenir ultérieurement. Mais « conscience », même en dehors de son aspect moral, peu rester un terme trop vague, lorsque par exemple on en fait le synonyme de « pensée » ou d’esprit au sens large (ex. « y a-t-il une conscience dans l’univers ? »); le philosophes avant Freud faisaient s’équivaloir « conscience » et « psychique », créant ainsi une impasse logique qui exclut d’avance, par pétition de principe, toute possibilité d’un psychisme inconscient.
À propos de la conscience, Freud a été, pour dire le moins, peu disert. Rappelons d’abord qu’il a essentiellement réduit l’importance et l’étendue de la conscience dans le domaine psychique. L’essentiel du psychique est selon lui (et désormais selon la plupart des auteurs, même en dehors de la psychanalyse) inconscient. Cependant si Freud n’a pas vraiment voulu s’engager dans une discussion en profondeur sur la nature de la conscience, il a quand même pris quelques positions assez précises. Ainsi, dans L’interprétation du rêve il affirme que le rôle de la conscience n’est « aucun autre que celui d’un organe sensoriel pour la perception des qualités psychiques » (I.R. p. 675; même idée en p. 180). Comme le soulignent Laplanche et Pontalis dans le Vocabulaire de la psychanalyse, Freud a constamment associé conscience et perception, posant même une fonction de perception-conscience (Pcpt-Cs) à une extrémité de l’appareil psychique (p. 95). Notons que cela n’exclut pas des perceptions non-conscientes, appelées aussi subliminales (sub-limen = sous le seuil de la conscience).
La conscience en tant qu’instance psychique se retrouve donc avec deux faces: une tournée vers le monde extérieur et l’autre vers les processus psychiques internes. Dans les deux cas, cependant, ce qui est spécifique à la conscience, c’est de percevoir des qualités à travers les organes des sens. Ceux-ci sont spécialisés pour capter diverses modalités ou qualités sensorielles: auditives, visuelles, tactiles, gustatives, olfactives à quoi il faut ajouter des perceptions proprioceptives comme les sensations cénesthésiques et, comme dit plus haut, la perception de qualités psychiques, principalement selon le bon ou le mauvais, le plaisant ou le déplaisant. C’est là une notion qui est assez classique: être conscient, c’est percevoir les choses qualitativement, la quantité pouvant quant à elle être tellement petite qu’elle échappe à la perception ou tellement grande qu’elle déborde, voire détruit l’appareil perceptif lui-même. (On peut donc sentir “quelque chose”, mais sans pouvoir le qualifier, donc sans pouvoir en être pleinement conscient.)
Laplanche et Pontalis écrivent aussi ceci: « Mais le problème le plus difficile est posé par la conscience de ce que Freud nomme “processus de pensée”, entendant par là aussi bien la reviviscence des souvenirs que le raisonnement et, d’une façon générale, tous les processus qui entrent en jeu dans les “représentations”. » (L&P, p. 95) Freud a toujours maintenu que le devenir conscient de ces processus passe par leur association avec des « restes verbaux » dont la réactivation donne lieu à une nouvelle perception: « les mots remémorés sont au moins à l’état d’ébauche, re-prononcés » (L&P, p. 95-96)
Notons maintenant que le système Pcpt-Cs est considéré par Freud comme le noyau du moi. Dans Le moi et le ça Freud est on ne peut plus clair: la perception est au moi ce que la pulsion est au ça. Mais cette liaison de la perception, et donc de la conscience, au moi, peut être trompeuse; elle ne doit pas être entendue comme si le moi était l’agent de la perception-conscience. C’est plutôt la fonction de perception-conscience qui entraîne la formation (et la constante reformation) du moi et celui-ci peut lui-même être en grande partie inconscient. Mais la liaison de la perception-conscience et du moi nous intéresse pour une autre raison: c’est que cette liaison rend d’emblée la conscience double. En effet, si les phénoménologues, à la suite de Thomas d’Aquin, de Brentano (professeur de philosophie de Freud et de Husserl) et de Husserl lui-même, ont établi qu’être conscient, c’est nécessairement être conscient de quelque chose, (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de conscience vide de contenu), nous pouvons quant à nous ajouter que devenir conscient de quelque chose c’est aussi simultanément être conscient de soi, ne serait-ce qu’à un plan implicite. Quand je prends conscience de ce que je suis en train de dire à l’analyste ou du paysage que j’ai devant moi, je deviens d’une part conscient de ce que je dis ou vois, mais aussi du fait que c’est moi qui le dis ou le vois. Je me reconnais le sujet de mon énonciation ou de mon regard. Devenir conscient, c’est donc devenir conscient de quelque chose et de soi simultanément, même si cette conscience de soi ne vient pas nécessairement se placer au premier plan 1
La conscience de soi peut donc être conçue comme l’aboutissement simultané de la prise de conscience tant du monde extérieur que de ce qui vient de l’inconscient. C’est l’acte d’assumer son rôle de sujet qui perçoit et qui se donne à soi-même un compte-rendu de la perception. La prise de conscience est donc inséparable d’une narration. Cette narrativité de la conscience, de son côté, n’est pas séparable d’une historicité: devenir conscient de quelque chose, c’est aussi l’insérer dans sa propre histoire. À son tour, cette historicité suppose une transformation de la temporalité: le temps de la conscience est un temps historique, chronologique, séquentiel. Le temps doit pour cela avoir été spatialisé, c’est-à-dire représenté comme quelque chose d’étendu dans l’espace et se déroulant dans une direction donnée (de gauche à droite, de l’arrière vers l’avant etc.) et pouvant être découpé en segments: pensons par exemple aux chronologies historiques comme la suite des rois de France ou celle des âges de pierre, de fer, de bronze…
Cette conscience de soi, on devine facilement qu’elle s’articule à l’image de soi et à l’investissement libidinal (narcissique) qui l’accompagne dans la constitution du moi spéculaire, tel que décrite dans « Le stade du miroir » par Lacan. Il faut donc que cet investissement de l’image de soi advienne dans les meilleures conditions afin que l’enfant assume sa présence au monde comme être séparé mais aussi comme sujet en devenir: sujet, c’est-à-dire (dans un apparent paradoxe terminologique) non–assujetti au vouloir ou au pouvoir de l’autre. Cela ne va pas sans un certain deuil. Piera Aulagnier, par exemple, souligne que dans la prise de conscience de soi spéculaire, le « Je suis cela » se double aussitôt d’un « Je ne suis que cela ». (Demande et identification, 1967) Ce « ne…que » est un prix à payer pour l’accès à un devenir potentiellement ouvert. Sauf que tout ne se règle pas au moment primordial de cette prise de conscience de soi. De même qu’on ne devient pas conscient une fois pour toutes, de même, conserver un statut de sujet libéré de l’emprise des imagos parentales dérivées de ceux qui ont joué un rôle décisif dans la conception, la naissance et les premières années de vie du sujet, c’est le combat de toute une vie.
Quel rapport avec l’hallucinatoire?
Je vais faire ici un détour, mais qui, j’espère, pourra vous intéresser. Vers le milieu des années 1970, un psychologue très érudit du nom de Julian Jaynes a publié un ouvrage qui fit beaucoup de bruit et a soulevé beaucoup de controverses. Ce livre s’intitule The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind. Il fut traduit en plusieurs langues, dont en français, sous le titre bizarrement tronqué La naissance de la conscience lors de l’effondrement de l’esprit (PUF, épuisé). Je ne sais pas pourquoi on a soustrait en français la référence à « bicameral » ce qui laisse entendre que c’est l’esprit au complet qui s’est effondré, alors que ce n’est pas ce que dit l’auteur.Peut-être est-ce parce qu’il est difficile de traduire correctement ou élégamment « bicameral mind »… Pourtant, ce terme de « bi-caméral » est important puisque l’esprit « à deux chambres » est justement l’hypothèse centrale de l’ouvrage, et c’est cet esprit, et non l’esprit en général qui a dû, selon Jaynes, s’effondrer afin qu’apparaisse dans l’histoire humaine la conscience.
Jaynes, tout comme Freud, commence par réduire à peu de chose la part de la conscience dans l’esprit humain. Il montre qu’elle ne sert ni à apprendre, ni à penser, ni à juger ou à raisonner, ni à décider, ni à mémoriser… Mais il se penche sur un aspect fort intéressant de la question en se demandant si les humains ont toujours possédé cette conscience réflexive. En se basant sur nombre d’éléments tirés de textes anciens comme l’Iliade, le code Hammurabi, les tablettes mésopotamiennes d’écriture cunéiforme, et invoquant aussi les fouilles archéologiques dans les tombes royales, les sculptures anciennes etc. il répond sans hésiter que non. Plus précisément, il émet l’hypothèse que la conscience telle que nous la connaissons est apparue quelque part entre le deuxième et le premier millénaire avant notre ère. Avant cette époque, Jaynes propose l’hypothèse que les humains hallucinaient les discours qui servaient à régler leur conduite. Ces discours étaient divins, et leur présence hallucinée survenait, selon Jaynes, dans des moments de tension, de stress provoqué par la nécessité de choisir entre deux conduites, deux décisions possibles. Selon cette hypothèse, les dieux parlaient donc directement aux hommes qui, de ce fait, n’avaient pas besoin de penser par eux-mêmes et n’avaient aucun sens d’être les auteurs de leurs décisions. L’esprit « bi-caméral » ne possédait qu’une « chambre » pour la réception des messages divins et une autre chambre pour l’exécution de ce que le dieu dictait. La conscience de soi leur faisait défaut, et dans ce sens Jaynes affirme qu’ils n’étaient pas conscients.
On aura compris que Jaynes ne dit pas que les dieux en question existaient vraiment au sens où nous parlons aujourd’hui d’existence. Mais pour les humains « bi-caméraux » la question de leur existence ne se posait même pas puisque c’était leur expérience quotidienne d’être en contact avec eux. Ces dieux pouvaient parler par l’intermédiaire d’un roi qui n’était alors qu’un intermédiaire, ou alors, dans certaines civilisations, le roi lui-même était le dieu. Dans tous les cas, leur parole hallucinée régulait les rapports humains et les conduites.
Je ne peux rapporter ici tous les arguments invoqués par Jaynes à l’appui de sa thèse, mais ils sont nombreux et intéressants. Un des plus élégants arguments est la lecture comparative de l’Iliade et de l’Odyssée, dont il indique que la première appartient à l’ère « bi-camérale », alors que la seconde est manifestement secondaire à l’effondrement de ce mode de fonctionnement psychique. Par exemple, dans l’Iliade, lorsque le roi Agamemnon vole à Achille sa maîtresse, il est dit qu’un dieu saisit ce dernier par les cheveux et l’avertit de ne pas se venger du roi. C’est l’intervention divine, donc, et non une réflexion personnelle qui règle sa conduite. Bien entendu, Achille et les autres personnages de l’Iliade peuvent n’avoir jamais existé, n’être que des personnages de légende, mais il reste que la conception de leur action est remarquablement différente de celle qui est présentée dans l’Odyssée, où c’est bien la pensée (et la ruse) d’un homme qui est la source de l’action. (Bien que toutes deux attribuées à Homère, il y a toute raison de croire que ces deux épopées ont été écrites et développées par de nombreux auteurs au cours de plusieurs siècles.)
Jonction avec la pensée freudienne
Il est important de prendre en compte les quatre facteurs requis selon Jaynes pour que l’esprit bi-caméral soit en place. Il faut, dit-il:
1- Un impératif cognitif collectif, c’est-à-dire un système de croyances et d’attentes;
2- Une induction, c’est-à-dire une procédure ritualisée restreignant l’état de conscience à un domaine précis;
3- Un état de transe, c’est-à-dire la conséquence de ce qui précède, avec la mise en suspens du “Je”, entraînant un rôle accepté et encouragé par le groupe social;
4- Une autorisation archaïque, c’est-à-dire une divinité ou une autorité terrestre à qui est attribuée l’autorité et le contrôle sur la transe (cela boucle la boucle avec le point 1).
Je n’entrerai pas dans le détail de ces quatre éléments, me contentant de souligner que l’on peut facilement y reconnaître tout ce qui est nécessaire à l’hypnose, ou à une puissante capacité de suggestion, phénomène que Jaynes reconnaît d’ailleurs comme vestige de l’esprit “bi-caméral”.
Or avec l’hypnose et la suggestion, nous nous retrouvons dans les parages de la naissance de la psychanalyse… Et si en lisant ce qui précède vous est venue à l’idée la notion de « surmoi », vous n’étiez pas dans l’erreur. Jaynes lui-même fait mention en passant de ce concept freudien, sans cependant développer, ni explorer plus avant les autres concordances possibles avec les hypothèses freudiennes. Mais ces concordances existent. Il suffit pour cela d’ouvrir notamment Psychologie des masses et analyse du moi. 2 C’est ce que je vous propose que nous fassions au cours des prochaines semaines. Cela nous fera approcher l’hallucinatoire sous un angle différent, complémentaire de celui adopté jusqu’ici.
NOTES
- On pourrait ici entrer dans une description plus fine du rapport entre le fait de percevoir, ce qui est perçu et ce que ça change pour le sujet qui perçoit. Par exemple, un certain spectacle peut faire en sorte que le sujet qui le perçoit s’oublie… Mais cette discussion nous éloignerait de notre propos. ↩
- Freud, S. (1921) Psychologie des masses et analyse du moi, Œuvres complètes, vol. XVI, p. 5-83. ↩