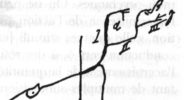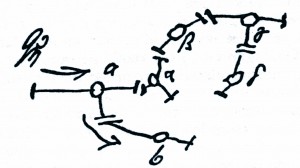À partir de ce que nous avons abordé dans les sections 5 et 6, soit la méthode de la « mise à plat » qui serait requise précisément parce que dans l’organisation de la psyché il s’est produit des « enroulements », je me propose maintenant d’examiner si cela peut nous aider à approcher la question de la pulsion sous un angle un peu différent.
J’ai déjà cité Laplanche, pour qui « toute topique est du moi ». Ne pourrait-on pas dire aussi que la pulsion est quelque chose qui peut être ressenti et pensé comme poussée parce que le moi essaie précisément de s’opposer au mouvement, à la transformation. Et si c’est le cas, il faut alors se demander pourquoi le moi s’y oppose 1. Nous l’avons vu: pour Freud, si le moi existe, il ne peut qu’inhiber les processus psychiques primaires, autrement dit, la vie hautement mobile de la psyché avant qu’elle ne se différencie. Ceci devrait, me semble-t-il, nous inciter à essayer de penser la pulsion comme ce qui se révèle lorsque les choses sont vécues du point de vue d’une instance qui par définition est appelée à la refuser. Ce point de vue du moi d’où émane toute conception topique, il nous faut d’abord essayer de le spécifier en nous demandant comment se produit cette différenciation topique qui conduit à la formation d’un moi au milieu du « désordre » primordial. Dans un deuxième temps, il nous faudra par contre nous demander ce que signifie la pulsion pour que le moi s’y oppose. Cette question revient à nous demander, comme nous avons commencé à le faire lors de notre récente rencontre, ce qu’on entend au juste par sexuel (ou sexual) en psychanalyse. Question, comme on l’a vu, assez difficile.
1- La différenciation topique.
On se souviendra que dans la Projet, Freud pose la formation du moi en termes d’un réseau de neurones « bien frayés » entre eux, c’est-à-dire fortement associés selon un principe qui, quelques cinquante ans plus tard, vers 1948, allait être repris dans le cadre de recherches en neurophysiologie, par le psychologue Donald Hebb, de l’Université McGill. Ce principe porte d’ailleurs encore le nom de « Loi de Hebb » et fait toujours autorité pour ce qui concerne la théorie des réseaux de neurones cérébraux. Cette loi s’énonce s’énonce ainsi: « Neurons that fire together, wire together. » (Des neurones qui déchargent simultanément s’associent entre eux.) Ce n’est pas le lieu ici d’entrer dans les détails, mais une lecture attentive du mécanisme appelé par Freud « frayage neuronal » montre aisément que c’est exactement la même idée que celle de Hebb. Ce dernier avait d’ailleurs une certaine connaissance de l’œuvre de Freud, mais il ne pouvait probablement pas avoir lu le Projet puisque la première publication de celui-ci (avec une partie de la correspondance Freud-Fliess) date de 1950. Hebb a donc formulé la même idée que Freud, mais en toute indépendance.
Ce qui devrait nous intéresser surtout ici c’est que, avec cette notion de frayage, Freud a imaginé une façon de rendre compte de l’amorce d’une différenciation topique majeure: la formation d’un moi à l’intérieur d’un réseau au début non différencié.
Bien entendu il s’agit d’un modèle théorique et, faut-il souligner, appartenant à un modèle neuronal; un modèle qui par ailleurs laisse de côté bien des aspects; par exemple: Quelles fonctions de ce moi sont innées? Lesquelles sont acquises et seront de nature pleinement psychique? Mais nous laisserons cela de côté pour le moment. Ce qui est plus fondamental, c’est que la constitution d’un tel réseau est l’équivalent du traçage d’une frontière, d’une limite; la constitution d’une forme délimitant un moi d’un non-moi (ou d’un « hors-moi »). Intéressant aussi est le fait que Freud n’invoque aucune intervention « magique », mais pose (tout comme Hebb le fera plus tard) que, par les lois mêmes du fonctionnement neuronal, quelque chose s’auto-organise, s’auto différencie. Cette auto-organisation est en parfaite congruence avec les conceptions les plus modernes de la compréhension des systèmes tant biologiques que sociaux. On peut faire appel ici à la notion d’autopoièse (Varela), et considérer ensuite le tracé du moi comme la constitution de ce que le même Varela appelle la « clôture opérationnelle ». Cette notion de « clôture opérationnelle » est fondamentale en ceci qu’elle délimite deux régimes de fonctionnement différents (et pas seulement en biologie, d’ailleurs). Les lois ne sont pas les mêmes à l’intérieur et à l’extérieur de cette clôture et dès lors que celle-ci existe, les échanges entre les deux parties du système ainsi constitué doivent se faire de manière à respecter le maintien de la dite clôture et de la différence qui s’est ainsi établie au sein du « tout » d’origine. L’enroulement dont nous avons déjà parlé à la section 6 n’est donc rien d’autre que ce tracé, cette partition qui scinde une (mythique) unité primordiale. Quelque chose s’inscrit dans cette unité, et en s’inscrivant elle la « déchire », la divise en deux parties distinctes, en un « dedans » et un « dehors » du moi 2.
Il est raisonnable d’imaginer que si Freud n’a pas publié le Projet, pourtant rédigé avec passion entre avril et septembre 1895, c’est qu’il savait bien que le modèle qu’il y avait déposé est purement fictif et qu’il ne tiendrait pas face à la critique de la part des neurologues. Ceux-ci se seraient sans doute insurgés contre l’absence de quelque base anatomique ou expérimentale que ce soit. N’oublions pas que nous sommes à l’époque des grandes découvertes concernant les aires cérébrales (de Broca, de Wernicke) et que les substrats anatomiques sur lesquels s’appuient ces découvertes sont de première importance, puisque c’est la corrélation entre les lésions observables (à l’autopsie) et les pertes fonctionnelles observées du vivant du patient qui ont permis d’identifier ces centres importants. Or Freud avait tenté, avec son Projet, quelque chose de beaucoup plus grandiose: fonder neurologiquement une « psychologie scientifique ». Autrement dit il a essayé d’imaginer ce que serait l’assise neurologique des fonctions les plus globales et les plus élevées: la mémoire, la pensée, le jugement etc. Il a voulu faire un très grand bond en avant, mais il savait bien que quantité de ses assertions auraient nécessité une masse énorme d’études neuro-anatomiques et neuro-physiologiques qui étaient alors hors de portée. Freud laisse donc le Projet dans ses tiroirs et se met plutôt à l’étude du rêve, c’est-à-dire à une approche purement psychologique des mêmes questions. C’est ce qu’on retrouve dans L’interprétation du rêve de 1900, dont il est maintenant acquis que le Chapitre 7 est une version « psychologique » de plusieurs éléments majeurs du Projet formulé cinq ans plus tôt. Ce qui est intéressant pour notre propos actuel est que, ce faisant, Freud a préservé une logique tout à fait semblable: il y a, dans le chapitre 7 également, une clôture opérationnelle, un « enroulement », qu’il prend même la peine de dessiner plus d’une fois 3.
2- Le sexuel (ou Sexual).
Il vaut la peine pour le moment de prendre en considération l’autre aspect de la question. Déjà, par la position du moi en tant qu’inhibiteur — chose établie dans le Projet, donc en 1895, c’est-à-dire avant qu’il ne soit question de pulsions dans la théorie de Freud —, il était inévitable que la seule pulsion dont le moi aurait à se défendre, c’est la pulsion sexuelle. Pourquoi cela? Tout d’abord, parce que en dehors de la (ou des) pulsion(s) sexuelle(s), il n’y a que des pulsions d’auto-conservation et l’on voit mal, du moins à première vue, pourquoi le moi se défendrait contre sa propre auto-conservation. Certes, la faim, la soif, le besoin de chaleur etc. sont aussi des « exigences de travail » imposées à la psyché du fait de sa liaison avec le corps, mais on n’entre pas en conflit avec la faim ou la soif, on ne peut de toute façon l’inhiber, sinon avec une stratégie très simple: celle qui consiste à la satisfaire. La fonction d’inhibition, il faut le remarquer, joue quand même un rôle ici: il s’agit du fait que la présence du moi impose un retard dans la production d’une réponse motrice à un stimulus quel qu’il soit. Mais en définitive, ce retard n’est pas de l’ordre du conflit, au contraire: en empêchant une réponse trop rapide, de type réflexe, le moi s’assure de ne pas s’épuiser en une vaine activité: il vérifie, avant de laisser la voie libre à la motricité, que ce qui est représenté dans la mémoire comme objet satisfaisant existe aussi dans le monde réel. L’inhibition dans ce cas est au service de la satisfaction effective 4.
Les pulsions sexuelles, pour leur part, peuvent être inhibées et même orientées vers autre chose que leur satisfaction « naturelle ». Un moi inhibiteur est dans ce cas capable, jusqu’à un certain point, de carrément refuser de donner accès à la satisfaction. La pulsion n’est pas pour autant détruite et elle exercera une pression constante, continuant de harceler, pour ainsi dire, le moi, puisque celui-ci est ce qui lui oppose un premier obstacle, interne à l’organisme. Et c’est ici que les destins particuliers de la pulsion sexuelle se révèlent, non comme des caractéristiques naturelles, mais plutôt comme les conséquences de l’inhibition elle-même, du retard dans la satisfaction qu’impose le moi.
L’approche que nous sommes en train de suivre ici me semble en mesure de nous informer un peu plus sur les caractéristiques propres du pulsionnel sexuel. Puisque nous disons que les pulsions d’auto-conservation (aussi appelées par Freud « pulsions du moi ») ne subissent un retard imposé par le moi que pour mieux être satisfaites (cela suppose évidemment des conditions de vie optimales), nous n’avons pas besoin de chercher très longtemps avant de constater que les pulsions sexuelles — relativement indépendantes du problème de la survie, voire mettant parfois celle-ci en danger —, peuvent du même coup se concevoir comme beaucoup plus mobiles, déplaçables, détournables; elles sont plus « aériennes », pourrait-on dire. Elles peuvent d’autant plus se faire insistantes, peu importe les circonstances, qu’elles ne sont pas de nature à imposer un seul type de satisfaction: la satisfaction réelle. Il y a, pour ainsi dire, une certaine « gratuité » de la pulsion sexuelle, prise à son niveau le plus simple, c’est-à-dire au niveau où on la compare aux pulsions du moi. Je souligne que je fais ainsi une énorme simplification découlant du fait que je décris ici les pulsions sexuelles comme si elles opéraient dans le même domaine que les pulsions d’auto-conservation. Or il n’en est rien, et nous aurons à reparler bientôt de cet aspect. Mais si nous poursuivons le parallèle, on voit tout de suite la pulsion sexuelle se mettre à dériver par rapport à la notion générique de pulsion. Alors même que nous essayons de la tenir sur le même plan que toute autre pulsion (au sens premier que donne Freud à ce terme et qui inclut les pulsions d’auto-conservation) on la voit commencer à s’échapper, à nous échapper. Les quatre composantes de la pulsion (source, poussée, but, objet) semblent assez appropriées pour des pulsions quelconques, mais on peut vite s’apercevoir que dans le cas de la pulsion sexuelle, elles s’appliquent de manière assez bancale.
On n’a pas suffisamment remarqué, à ce sujet, ce sur quoi la structure même du texte Pulsion et destins de pulsions devrait nous alerter : que beaucoup de choses que nous sommes portés à appliquer à la notion de pulsion sexuelle ne sont en fait, dans le texte de Freud, que relatives à la pulsion quelconque. Or la pulsion quelconque, c’est la pulsion d’auto-conservation. Quant à la pulsion sexuelle, elle est vraiment à part, et cela même si Freud ne semble pas le remarquer, ou en tout cas ne pas le dire explicitement dans ce texte. Pourtant, ce sont les développements mêmes apportés par Freud dans la deuxième section de ce texte qui nous forcent à nous apercevoir du caractère singulier de la pulsion sexuelle, de ce en quoi elle ne s’apparente que très peu aux pulsions en général.
On peut dire que la pulsion sexuelle se démarque, dérive, voire décolle (prend son envol) non seulement par rapport à la généralité de la pulsion, mais également par rapport à la notion commune de sexualité. Ceci est quelque chose de très spécifique à la psychanalyse et qui s’impose à mesure que l’on creuse les textes de Freud, parfois indépendamment du texte manifeste. Il faudrait idéalement se tourner de nouveau vers Trois essais sur la théorie sexuelle, mais comme nous sommes dans Pulsion et destins de pulsions, je crois qu’il vaut mieux rester encore un certain temps sur ce texte qui est très parlant.
La loi d’inertie
Je disais donc que la pulsion est ce à quoi est confronté le moi du moment que, suivant Freud, on le conçoit comme avant tout une fonction d’inhibition. Mais ici un lecteur attentif aura remarqué que Freud, dès les premières pages de Pulsion et destins de pulsions, pose ce qu’il appelle « une présupposition fondamentale », et même « la plus importante de ces présuppositions », une de celles dont il disait dans son introduction au texte, qu’elles guident l’élaboration d’un concept et la cueillette des données de l’expérience. Je le cite:
« Elle [cette présupposition] est de nature biologique, elle travaille avec le concept de tendance (éventuellement celui de finalité) et s’énonce: le système nerveux est un appareil auquel est impartie la fonction d’éliminer de nouveau les stimuli qui lui parviennent, de les ramener à un niveau aussi bas que possible, ou qui voudrait, si seulement cela était possible, se maintenir absolument sans stimulus. » (Italiques ajoutés par moi.)
Un peu plus bas dans le même paragraphe, il appelle cela « [l’] intention idéale » de l’organisme, et je crois qu’il vaut la peine de souligner ce terme d’idéal sur lequel nous pourrions avoir à revenir. Pour l’instant, toutefois, il nous faut prendre en considération un petit problème. C’est que, à première vue, si l’ensemble du système vise à ramener les stimuli à un niveau aussi bas que possible ou, idéalement, à se maintenir absolument sans stimuli, on a donc l’impression que déjà la pulsion n’est pas la bienvenue non seulement dans le moi, mais dans tout le système. Comment, en effet, concilier les pulsions qui surgissent dans l’organisme en tant que stimuli internes et continus, avec un système nerveux qui veut s’en débarrasser le plus vite et le plus totalement possible? Le « système » serait-il en conflit avec lui-même? Ou peut-être faut-il ici entendre l’expression « système nerveux » comme équivalent du « moi »? Ce serait une option à la rigueur soutenable, mais je crois que s’offre à nous ici l’occasion de dégager une particularité de la pensée freudienne : c’est qu’elle comporte une sorte de structure « gigogne ». Je veux dire par là que Freud décrit des situations à deux niveaux, « macro » et « micro », mais en y voyant à l’œuvre une même loi de fonctionnement, ou à tout le moins un fonctionnement analogue. Ainsi, ayant constaté, avec la neurologie de son temps, que le neurones, pris isolément, sont des cellules dont la stimulation reçue est aussitôt transmise aux neurones voisins, il en déduit que tout neurone a pour première propriété de se débarrasser dès que possible de la « quantité » de stimuli reçue et de revenir à l’état de repos. C’est le « principe d’inertie neuronale » décrit en 1895, qui, comme on peut le remarquer dans la citation ci-dessus, sera plus tard transposée à tout le système nerveux.
On voit donc que, d’une part, Freud pense encore, en 1915, en s’appuyant sur ce que l’expérience neurologique lui a enseigné. D’autre part, que cette neurologie est « datée ». Si on peut se permettre une brève digression neurologique, on notera qu’en effet, selon la neurologie contemporaine, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu’énonce Freud, tant en 1895 qu’en 1915. Au niveau des neurones, la transmission de la « quantité » n’est plus tout à fait comme la concevait Freud : les molécules de neurotransmetteurs libérées dans l’espace synaptique ne comportent pas une « quantité », mais plutôt une « information » qui peut être excitatrice ou inhibitrice selon les neurotransmetteurs et les types de cellules impliqués. Cependant, la notion de quantité n’est pas complètement disparue : elle se retrouve dans la force des connections synaptiques. En effet, on sait maintenant que le renforcement d’une connexion synaptique se fait par la croissance, le long des axones et des dendrites, d’un plus grand nombre d’épines synaptiques, ce qui amplifie la communication synaptique. On pourrait ainsi parler, sinon de quantité, du moins de plus ou moins grande « densité » du réseau de connections, ce qui n’est qu’une autre version de la quantité. Par ailleurs, dans la construction de réseaux de neurones artificiels, comme il s’en fait dans les recherches actuelles, on parle de « poids synaptique ». Tout cela pour dire qu’on n’en a pas vraiment fini avec la quantité. 5
Retenons également que dans ce qu’écrit Freud, la tendance à l’élimination des stimuli est posée comme une présupposition théorique, comme un principe ou encore comme une visée « idéale », un « si seulement cela était possible » . On reconnaît-là une « machine helmholtzienne », du nom de Helmholtz, un des grands savants dans la lignée de qui s’inscrivait Freud. Ce modèle helmholtzien est repris présentement par un chercheur renommé en neurosciences, du nom de Karl Friston 6. Cette « machine helmholtzienne » est, elle aussi, théorique; elle décrit les formules régissant un organisme ou un système biologique (le cerveau, notamment) dont la loi générale est de fonctionner de manière à tenir au plus bas niveau l’énergie libre, c’est-à-dire le désordre. Freud appelait cela: lier la quantité d’excitation et dans sa dernière théorie de l’appareil psychique il dit de cette fonction de liaison que c’est la principale tâche de l’appareil 7. Pour rendre plus palpable l’intérêt de cette notion, Friston explique que cela pourrait se formuler par cette visée : éviter le plus possible la surprise, ce qui, une fois de plus, s’accorde très bien avec la théorie freudienne, Je pense ici à la théorie exposée dans Au-delà du principe de plaisir à propos du traumatisme: celui-ci se produit lorsque l’appareil psychique est pris dans un état d’impréparation (la surprise, c’est cela) et n’a pas la possibilité de mobiliser les défenses.
On voit donc que la « biologie freudienne », si on peut l’appeler ainsi, peut à la fois être assez vieillotte et cependant comporter des vues qui tiennent encore la route aujourd’hui sous des aspects essentiels. On voit aussi, ave Friston, que des concepts psychologiques, comme celui de « surprise », ne tardent pas à se montrer dès qu’on se pose la question du sens que les fonctions neuronales peuvent bien « incarner ». Autrement dit, la neurobiologie a ceci de particulier qu’elle ne tarde pas à conduire vers des conceptions psychologiques. Encore faut-il passer d’un domaine à l’autre en y mettant toutes les précautions nécessaires.
Jusqu’ici, nous avons donc examiné la pensée de Freud sur les pulsions en suivant la ligne théorique plus ou moins neurobiologique qui remonte assez loin dans les débuts de son œuvre. Mais au fait, qu’avait-il donc observé chez ses patients pour essayer de penser selon ces termes? Et quelle version pleinement métapsychologique peut-on dégager de tout cela? [À suivre].
NOTES
- Note après-coup (Octobre 2016): On trouvera dans l’article portant le numéro 11.3 et intitulé « Processus et hypostase » une explicitation, sous un tout autre angle, du problème de l’opposition du moi à la pulsion. On verra que ce n’est pas tant que le moi s’oppose au mouvement; c’est qu’il est un moment d’arrêt des processus psychiques. ↩
- Voir Derrida, « Freud et la scène de l’écriture », in L’écriture et la différence, Seuil, coll. Points. Voir aussi J.F. Lyotard, « Logos et technè, ou la télégraphie », in L’inhumain, Galilée, 1988, réédition Klincksieck, 2014. ↩
- Nous reviendrons sans doute sur cet aspect, mais pour qui veut s’avancer sur la question, voir J. Laplanche, Problématiques V, Le Baquet – Transcendance du Transfert, PUF, coll. Quadrige. ↩
- Voir S. Freud, « La négation » (1925). ↩
- Au plan clinique, l’œuvre de Michel de M’Uzan est exemplaire par l’usage fréquent qu’il fait de la notion de quantité, ou si l’on veut, du point de vue économique. Voir notamment son fameux article « Les esclaves de la quantité », in La bouche de l’inconscient, Paris, Gallimard, 1994. ↩
- Pour les plus curieux, ou courageux, d’entre vous, je mets dans la section « documents » un article de Friston, bien qu’il s’avère assez éloigné de notre type habituel de lectures. ↩
- Cf. Au-delà du principe de plaisir. ↩